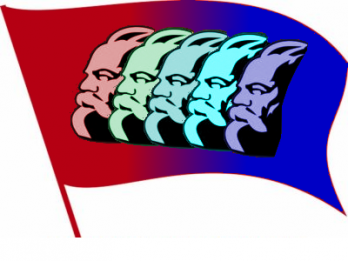Révisionnisme (années 1890)
Le révisionnisme des années 1890, notamment dans le Parti social-démocrate allemand (SPD) avec Eduard Bernstein, mais plus généralement dans la IIe internationale, fut une remise en question de la perspective révolutionnaire du marxisme, afin d'aller vers un parti réformiste parlementaire, voire de gouvernement. En Allemand ce débat est connu sous le nom de Reformismusstreit - la "querelle réformiste".
Le révisionnisme de cette époque est souvent étudié par les marxistes révolutionnaires comme un fait révélateur de l'évolution de la social-démocratie vers le réformisme (l'idéologie s'adaptant à la pratique) et le nationalisme (via l'influence de l'idéologie dominante). Ce réformisme est apparu assez clairement lors de la première guerre mondiale (union sacrée) et de la vague révolutionnaire qui l'a suivie.
1 Contexte et analyse[modifier | modifier le wikicode]
1.1 Le marxisme reconnu...[modifier | modifier le wikicode]
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'Allemagne connaît une industrialisation rapide, et une classe ouvrière massive et relativement instruite se forme.
Face à l’État réactionnaire et en l'absence d'une bourgeoisie libérale forte, le progressisme s'est cristallisé dans le mouvement socialiste, rejoint par de nombreux intellectuels issus de la bourgeoisie. Dans un premier temps, le socialisme scientifique de Marx et Engels battait en brèche les conceptions utopistes et réformistes, notamment lassaliennes en Allemagne. Un certain Eduard Bernstein aida même Engels à publier les ouvrages des deux fondateurs du marxisme.
Lorsque le SPD est légalisé en 1891, le parti se dote d'un programme lors du congrès d'Erfurt qui semble entériner l'hégémonie du marxisme. Ailleurs, en Europe, celui-ci gagnait rapidement du terrain.
1.2 ...mais pas réellement appliqué[modifier | modifier le wikicode]
Rétrospectivement, on peut toutefois remarquer une faille : le programme est très nettement séparé en une partie théorique, rédigée par Kautsky et reprenant les concepts marxistes et le but final du communisme, et une partie rédigée par Bernstein, qui liste les revendications immédiates : protection des plus démunis, laïcité, égalité entre les hommes et les femmes... Il n'y a pas de méthode transitoire explicitée.
En pratique, le SPD s'investissait beaucoup dans l’activité électorale (obtenir plus de représentation au Reichstag) et l’activité syndicale, et y obtenait des succès significatifs. Mais ces succès tendaient eux-même des pièges à la social-démocratie...
- Le SPD, tout en étant le plus grand parti politique en Allemagne, était surpassé en nombre au Reichstag par la combinaison de ses opposants aristocratiques et bourgeois. C'est pourquoi au sein de la social-démocratie, en particulier dans le Sud de l’Allemagne, une forte pression existait pour une alliance parlementaire avec les bourgeois libéraux.
- La question syndicale fut encore plus déterminante. Alors que c'est le SPD qui avait fait émerger les syndicats dans les années 1870 et 1880, la situation s'est inversée lorsque les syndicats se sont développés plus rapidement que le parti. Les syndicats, de plus en plus englués dans la collaboration de classe, exercèrent une influence néfaste sur le SPD.
La forte croissance jusqu'en 1914 et les fortes plus-values de cette période qui s'ouvrait (l'impérialisme) eurent des effets positifs sur les conditions de vie de larges sections de la petite bourgeoisie et de certains ouvriers. Les empiristes vulgaires y ont vu un capitalisme à visage humain, et l'heure était au positivisme, à la dénonciation d'un marxisme trop catastrophiste, etc... La véritable aristocratie ouvrière qui se développait à la tête des syndicats et des partis (parmi les députés notamment) constituait une base sociale réceptive à ce révisionnisme qui lui susurrait qu'elle avait tout intérêt à garder son poste dans un système qui n'était pas si mauvais... L'éclatement de la Première guerre mondiale fut un démenti dans les faits à ces thèses, mais les dégâts étaient déjà faits, et l'aile réformiste n'aurait alors plus le même intérêt de classe que la majorité des ouvriers...
Mais Kautsky et Bebel, à la direction du SPD, défendaient officiellement la ligne marxiste du parti, le premier par ses écrits, le second par des discours fleuves aux congrès. Cet écart grandissant entre théorie et pratique constituait un terreau propice au révisionnisme.
2 Le révisionnisme en Allemagne[modifier | modifier le wikicode]
2.1 Le réformisme lassalien[modifier | modifier le wikicode]
Le courant autour de Lassalle préconisait de collaborer avec l’État pour obtenir des réformes démocratiques et sociales - Lassalle ayant même collaboré avec Bismarck. Ce courant avait été marginalisé, à la fois parce que la répression antisocialiste de Bismarck rendait son réformisme inapplicable, et parce que les marxistes avaient gagné la bataille des idées.
Mais dès la légalisation du SPD en 1891, les lassaliens se firent à nouveau entendre dans le parti. Quatre mois avant le congrès d'Erfurt, Georg von Vollmar fait des discours à Munich défendant ce qu'il appelle un "socialisme concret" : se concentrer sur la « coopération avec les forces bourgeoises progressistes » pour obtenir des réformes. Il donnait comme image : « A la bonne volonté la main ouverte ; à la mauvaise les poings fermés. »
Vollmar est critiqué, mais pas désavoué. Il parviendra même à se faire un bastion en Bavière, où le SPD mena une politique de collaboration de classe dès 1893. Il ne s'agit pas à proprement parler de révisionnisme, puisque les lassalliens n'ont jamais été marxistes, n'ont jamais porté la perspective de la révolution socialiste.
En revanche, il est frappant de constater à quel point la direction centriste a capitulé devant ce courant réformiste. Bebel ne fit pas de critique sur le fond, et se montra même conciliant en expliquant que ce réformisme ne faisait que théoriser ce que le SPD faisait aussi. Il se borna à dire qu'il ne fallait pas oublier le but final.
« Si nous écartons dans un lointain brumeux notre but splendide en soulignant que les générations futures seulement pourront l'atteindre, c'est à juste titre que la masse nous échappera ».
Le problème était purement pratique à ses yeux : « Vollmar enlevait au parti son enthousiasme, sans lequel un parti comme le nôtre ne peut vivre ». La capitulation de sa propre responsabilité de dirigeant apparaît crûment dans une lettre à Victor Adler peu après le Congrès, où il admet que le réformisme gagne du terrain, mais s'en remet aux lois de l'histoire ! « Mon seul espoir réside dans le fait que l'ordre des choses et la puissance de l'évolution sont plus fortes que la volonté des chefs, et que la poussée d'en bas se manifestera au moment opportun, si les dirigeants freinent trop visiblement »[1]
2.2 Le révisionnisme d'Eduard Bernstein[modifier | modifier le wikicode]
2.2.1 Premiers symptômes[modifier | modifier le wikicode]
Eduard Bernstein correspondait fréquemment avec Engels, qui l'appréciait et lui faisait confiance. Dans les années 1880, certaines pressions opportunistes commençaient à se faire sentir, notamment dans les syndicats. Par exemple :
- certains glissaient vers un soutien à Bismarck, qui avait mis en place des mesures de protection sociales (en même temps que les lois antisocialistes),
- quand l’État allemand a mis en place des subventions pour la construction de bateaux à vapeur militaires (l'impérialisme allemand était en train d'émerger), certains se sont réjouit des emplois stables que cela créait pour les ouvriers.
En ce temps-là Bernstein tenait une ligne juste dans le parti, en combattant ces dérives.
Assez tôt cependant, il avait manifesté une tendance à diluer le marxisme dans l'humanisme petit-bourgeois. A la fin des années 1870, il s’était aligné avec Karl Höchberg, un riche bienfaiteur du jeune mouvement social démocrate, qui croyait que le socialisme aurait de meilleures chances s’il essayait de plaire, sur une base éthique, aux classes moyennes. Bernstein voulait que le SPD soit non pas le parti du prolétariat, mais le parti du "peuple". Mais sous la pression de Bebel et Engels, Bernstein avait abandonné cette position.
2.2.2 L'influence anglaise[modifier | modifier le wikicode]
Par la suite, Bernstein s’installa en Angleterre où il développa des relations très amicales avec les représentants du mouvement réformiste Fabian. Il a manifestement été marqué par ses expériences en Angleterre, où le réformisme travailliste s’était développé comme de la mauvaise herbe à la suite de l’effondrement du chartisme révolutionnaire. L'Angleterre était le premier pays où l'impérialisme moderne s'était développé, et avait permis l'émergence d'une aristocratie du travail et cette tendance se généralisait effectivement dans cette période. Avec la classe moyenne stable et le système parlementaire légitimé de l'Angleterre, la perspective d’un renversement révolutionnaire du capitalisme semblait fort éloignée à Bernstein.
2.2.3 Engels ne se reconnaît plus[modifier | modifier le wikicode]
Au début de 1895, Engels fut profondément attristé lorsqu’il découvrit que son introduction à une nouvelle édition à Les luttes de classes en France, écrit par Marx en 1850, avait été publiée par Bernstein et Kautsky d’une façon qui donnait l’impression que le vieux révolutionnaire était devenu un disciple d’une voie pacifique vers le socialisme. En avril 1895, seulement quatre mois avant sa mort, Engels écrivit avec colère à Kautsky:
« A mon étonnement, je vois aujourd'hui dans le Vorwaerts un extrait de mon introduction reproduit à mon insu, et arrangé de telle façon que j'y apparais comme un paisible adorateur de la légalité à tout prix. Aussi, désirerais-je d'autant plus que l'introduction paraisse sans coupure dans la Neue Zeit, afin que cette impression honteuse soit effacée. Je dirai très nettement à [Wilhelm] Liebknecht mon opinion à ce sujet, ainsi qu'à ceux, quels qu'ils soient, qui lui ont donné cette occasion de dénaturer mon opinion et qui plus est sans m’en avoir informé en aucune manière. »[2]
2.2.4 Un capitalisme stabilisé, le marxisme périmé[modifier | modifier le wikicode]
La mort d’Engels semble avoir eu pour effet de libérer la parole de Bernstein. En 1896, il écrit à Kautsky :
« Pratiquement, nous ne formons qu’un parti radical ; nous ne faisons que ce que font tous les partis bourgeois radicaux, si ce n’est que nous le dissimulons sous un langage entièrement disproportionné à nos actions et à nos moyens. »
En octobre 1896, il écrivit un article dont le sujet était Problèmes du Socialisme et qui marqua le début de sa répudiation ouverte du programme révolutionnaire du marxisme. Son article commençait par noter l’avancée rapide et l’influence croissante du mouvement socialiste en Europe. Même les partis bourgeois devaient prêter attention aux revendications avancées par les socialistes. Mais pour Bernstein, cela signifiait surtout qu'il fallait abandonner l’attitude "négative" à l’égard de la réalité existante, mais « aller de l’avant avec des propositions de réforme positive. »[3]
Au cours des deux années suivantes, culminant avec Les Présupposés du Socialisme (1899), Bernstein devait élaborer sa critique du marxisme "orthodoxe". Ces écrits clarifièrent le fait qu’il rejetait tout du marxisme. Il rompait avec la dialectique de Hegel, il rejetait la théorie de la valeur, il prônait l'abandon de la révolution pour se concentrer sur les réformes, sous prétexte que c'est cela le socialisme concret : « le but final, quel qu'il soit, ne signifie rien pour moi, le mouvement est tout »[4]. Bernstein soutenait que le développement réel du capitalisme avait réfuté les analyses économiques de Marx. Se basant sur la tendance à la prospérité de la Belle Époque, il affirma qu'il n'y avait pas de tendance à la prolétarisation et à la paupérisation.
Plus profondément, Bernstein répudiait ce qu’il appelait le « catastrophisme », la croyance que le capitalisme se dirigeait du fait de ses contradictions internes vers une crise extrême. Tout en reconnaissant la possibilité de crises périodiques, Bernstein insistait pour dire que le capitalisme avait développé et continuerait de développer « des facteurs d’adaptation » — tel que l’utilisation du crédit — à travers lesquels de telles crises pourraient être soit indéfiniment reportées soit atténuées.
« Je me suis opposé à la conception selon laquelle nous serions au seuil d’un effondrement imminent de la société bourgeoise, et à ce que la Social Démocratie puisse permettre que ses tactiques soient déterminées par, ou soit rendues dépendantes, de la perspective d’une catastrophe majeure prochaine de ce genre quelle qu’elle fût. Je maintiens cette conception dans tous les cas de figure. » Bernstein au congrès de Stuttgart, 1898[5]
En liant avec sa vision d'un capitalisme fondamentalement stable, il ne voyait pas du tout le chemin objectif vers une révolution socialiste, et donc a fortiori vers la société communiste qu'elle engendrerait :
« Si l’on entend par réalisation du socialisme l’établissement d’une société réglée en tout point d’une manière rigoureusement communiste, je n’hésite assurément pas à déclarer qu’elle me paraît se trouver dans un avenir passablement lointain »
C’était là un point central : le problème n'est pas d'attendre une « catastrophe », mais de savoir si oui ou non il existe un lien objectif entre le socialisme et les contradictions du capitalisme, sur lesquelles les révolutionnaires peuvent s'appuyer. Si un tel lien fait défaut, alors il est impossible de parler du socialisme comme d’une nécessité historique.
2.2.5 Vers un humanisme kantien[modifier | modifier le wikicode]
Qu’est-ce qui alors, en l’absence de la nécessité, fournissait la justification du socialisme ? Certains partisans de Bernstein, cherchant une nouvelle cohérence idéologique, avancèrent l'idée de bases éthiques, comme l’application dans la sphère de la politique de l’impératif catégorique de Kant, qui comprend l’injonction suivante : « Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. » Durant les années 1890 il existait, dans le milieu universitaire, un groupe important de néo-kantiens qui croyaient que l’impératif catégorique de Kant conduisait logiquement au socialisme. Certains, comme l’éminent philosophe néo-kantien Morris Cohen, soutenait que Kant devait être considéré, sur la base de ses conceptions éthiques, comme « l’authentique et véritable fondateur du socialisme allemand. »[6]
C’était à la fois faux et naïf. L’impératif catégorique occupe dans la sphère de la conduite éthique la même place que le sens commun occupe, en général, dans les activités au jour le jour d’une personne ordinaire. Tout comme l’application du sens commun peut produire des résultats tout à fait satisfaisants dans toutes sortes de situations peu contraignantes, l’impératif catégorique peut servir de guide pour un comportement acceptable à l’intérieur d’un cadre social limité. Dans la conduite de relations purement privées et personnelles, il serait éminemment louable de traiter ses semblables comme une fin, plutôt que comme un moyen. Mais dans la sphère publique, toute forme d’adhésion stricte à cet impératif est extrêmement problématique.
L’application universelle de cette maxime dans une société divisée en classes est, dans tout sens politique sérieux, impossible. Kant, qui vivait bien avant que le capitalisme industriel ne se soit développé largement en Allemagne, ne pouvait pas avoir compris que son postulat éthique central était objectivement irréconciliable avec les rapports de production de la société capitaliste. Pour le capitaliste, le travailleur salarié est un moyen par lequel la plus-value et le profit sont produits, et c'est un fait structurel qu'aucune morale ne peut suffire à surmonter.
2.2.6 Plékhanov et Rosa Luxemburg réagissent[modifier | modifier le wikicode]
Au sein du Parti social-démocrate allemand, il y eut au début une grande réticence à affronter Bernstein publiquement. Ce furent les marxistes russes, d’abord Parvus et ensuite Plekhanov, qui insistèrent pour mener une lutte ouverte et sans concession contre les révisions de Bernstein. Plekhanov, employant son approche bien connue de la polémique théorique où ne « faisait pas de prisonniers », écrivit une série d’essais meurtriers qui révélait aux yeux de tous la faillite des conceptions philosophiques de Bernstein. Ces essais sont parmi les meilleures expositions de la méthode dialectique et des fondations théoriques du marxisme. Bien plus connu encore est le brillant travail polémique de Rosa Luxembourg, alors âgée de 27 ans, Réforme sociale ou révolution ? (1898) Dans le premier chapitre de sa brochure, elle résume avec concision le problème fondamental que posait l’attaque du marxisme par Bernstein :
« La théorie révisionniste est confrontée à une alternative : ou bien la transformation socialiste de la société est la conséquence, comme auparavant, des contradictions internes du système capitaliste, et alors l’évolution du système inclut aussi le développement de ses contradictions, aboutissant nécessairement un jour ou l’autre à un effondrement sous une forme ou sous une autre ; en ce cas, même les " facteurs d’adaptation " sont inefficaces, et la théorie de la catastrophe est juste. Ou bien les " facteurs d’adaptation " sont capables de prévenir réellement l’effondrement du système capitaliste et d’en assurer la survie, donc d’abolir ces contradictions, en ce cas, le socialisme cesse d’être une nécessité historique ; il est alors tout ce que l’on veut sauf le résultat du développement matériel de la société. »[7]
En lisant Les Présupposés du Socialisme, on ne peut s’empêcher d’être stupéfait de constater à quel point Bernstein semblait totalement inconscient des sinistres grondements se produisant sous la surface de la société capitaliste fin de siècle. Il supposait avec une complaisance stupéfiante que les indicateurs du développement économique évolueraient indéfiniment de façon positive, élevant régulièrement le niveau de vie des masses. L’idée d’une crise majeure semblait à Bernstein être une pure folie. Même les avertissements que le phénomène nouveau du colonialisme et du militarisme conduirait à un affrontement violent entre des États capitalistes massivement armés était rejetée d’emblée par Bernstein :
« Heureusement que nous sommes de plus en plus habitués à régler les différents par d’autres moyens que par l’utilisation des armes à feu. »[8]
2.2.7 Les principes maintenus... en théorie[modifier | modifier le wikicode]
Malgré la réticence des dirigeants de la social-démocratie Allemande, une lutte ouverte contre les vues de Bernstein ne pouvait être évitée.
À partir de 1897, les réformistes disposent de leur propre organe de presse, les Sozialistiche Monatshefte. Cette publication mensuelle vient directement concurrencer Die Neue Zeit, l'hebdomadaire marxiste de Karl Kautsky qui dispose du statut de périodique intellectuel officiel du SPD.

Lors du congrès de Hanovre en 1899, les idées de Bernstein furent officiellement condamnées, par la gauche révolutionnaire (Luxemburg), par le centre (Bebel écrit Attaques contre les principes et les prises de position tactiques du parti) et par un vote majoritaire (216 voix contre 21). A un niveau théorique, le règne du marxisme était absolu. Mais à un autre niveau, celui de la pratique et de l’organisation du parti, la lutte contre le révisionnisme théorique n’eût aucun impact quel qu’il soit. La question fut soulevée à nouveau lors des congrès suivants. Au congrès de Lübeck en 1901, il est même voté une profonde concession aux opportunistes : le vote des budgets (de plus en plus fréquent) est autorisé à titre "exceptionnel". Au congrès de Munich en 1902, le courant réformiste demande à ce que Die Neue Zeit, supervisé par Kautsky, ne soit plus le journal officiel, mais le journal d'une sensibilité seulement - même majoritaire pour l'instant. Lors du congrès de Dresde en 1903, le réformisme est condamné à une plus grande majorité encore qu'au congrès de 1901.
Très significative est la réaction d’Ignaz Auer (secrétaire du parti de 1890 à 1904), célèbre pour son nationalisme et son refus de reconnaître l’autorité de l’Internationale, qui apostrophe Bernstein : « Edouard, tu es un âne ; on n’écrit pas ces choses, on les pratique. »
Quand Plekhanov invita le SPD à expulser Bernstein, la proposition fut rejetée d’emblée par les dirigeants du parti. Il n’y avait pas de réelle volonté parmi les dirigeants du parti d’explorer et d’exposer le lien tout à fait réel existant entre la théorie révisionniste et la pratique et l’organisation du SPD. L’avoir fait aurait inévitablement remis en question la relation entre le SPD et les syndicats qui étaient, du moins sur le papier, sous le contrôle du parti jusqu'en 1906.
Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles la perspective d’une lutte ouverte contre les formes pratiques de l’opportunisme, en particulier celles associées avec la pratique au jour le jour des syndicats, n’enthousiasmait pas les dirigeants du SPD. Ils craignaient qu'une telle lutte puisse faire éclater le parti, entraîner une rupture dans les rangs de la classe ouvrière, compromettre des décennies de progrès organisationnels et même faciliter la répression étatique contre le SPD. Ces inquiétudes étaient d’importance. Et pourtant, les conséquences de l’esquive par le SPD de la lutte contre l’opportunisme politique furent profondes et tragiques. Une des leçons à tirer, c'est l'importance du combat politique contre le centrisme, cette attitude de conciliation entre aile réformiste et aile révolutionnaire.
2.3 Le débat sur la grève générale[modifier | modifier le wikicode]
Entre l'aile droite et le centre « orthodoxe » de Bebel et Kautsky, que l’on peut qualifier d’attentiste, il y a encore une grande distance au début du 20e siècle. L’aile droite est tenue en échec par l’alliance des centristes et de la gauche. Cela est vrai jusqu’en 1906-1907, mais la discussion sur la grève générale et sur la révolution russe de 1905, puis la montée des luttes ouvrières qui s’opère à la même époque, vont modifier la donne et révéler la nature de la bureaucratie et sa réelle emprise.
Le boom économique s’accompagne d’une hausse des prix, les luttes sociales se multiplient, des vagues de grèves se produisent à partir de 1905 et se poursuivent selon les pays jusqu’en 1912. La crise révolutionnaire en Russie tout au long de l’année 1905 va impulser de nouveaux débats portant sur la grève générale. Peu avant en Belgique avait éclaté une grève générale pour le suffrage universel. En Allemagne, le gouvernement, inquiet des progrès électoraux de la social-démocratie, apporte des restrictions aux modes de scrutin.

En 1905, l'Allemagne est secouée par une vague de grèves que la direction syndicale fait tout pour canaliser, notamment la grève des mineurs (qui menaçait l'économie de paralysie) qu'elle incite à reprendre le travail. Les syndicats allemands tiennent leur congrès à Cologne en mai 1905, et condamnent l'usage de la grève générale (que Carl Legien appelait « l'obscurité générale ») et même le fait de faire de la propagande pour. Ils soutenaient qu'ils n'avaient pas les moyens pour soutenir une grève générale et qu’ils avaient besoin de la paix sociale pour continuer leur progression numérique. Quelques mois plus tard, au congrès du parti, Bebel marque son hostilité aux révisionnistes qui rejettent la grève générale, affirmant que « la grève des masses doit être retenue comme une mesure défensive ».
Il reçoit le soutien de Rosa Luxemburg, qui rentre de Russie et publie Grève de masse, Parti et syndicat, où elle réfute les positions des syndicalistes : elle dénonce leur caractère mécanique (attendre que toute la classe ouvrière soit organisée), leur attitude de comptable (les caisses des syndicats ne permettent pas de soutenir une grève générale) et met en avant que c’est dans la lutte que les travailleurs réalisent les plus grands progrès dans leur organisation et donc dans leur auto-émancipation.
Mais l’agitation sociale en Allemagne gagne en ampleur. Les chefs des syndicats traitent Luxemburg d’anarchiste, et la direction du parti est prise de vertige face à la puissance de la protestation ouvrière.
2.4 Le retournement de 1906[modifier | modifier le wikicode]
Au congrès du SPD en 1906, la direction et les syndicats décident de mettre sur un pied d’égalité les deux organisations. Dorénavant, les décisions essentielles devront être prises en commun. La bureaucratie va tout mettre en œuvre pour freiner les luttes.
Au congrès international de Stuttgart en 1907, Bebel repousse avec le droitier Vollmar la proposition des délégués français de lancer une grève générale en cas de guerre. Quelques mois après, au congrès du SPD, Bebel va plus loin, non seulement il couvre les déclarations patriotiques du député socialiste Noske au Reichstag, mais il se refuse à faire la distinction entre guerre défensive et guerre d’agression. Il déclare :
« Si nous devions vraiment défendre une fois la patrie, nous la défendrions alors parce que c’est notre patrie (…), parce que nous voulons faire de notre patrie un pays qui n’aurait nulle part dans le monde rien de semblable ».
Le rapprochement entre le centre et la droite est un fait acquis.
Bien que la majorité du congrès réaffirme sa condamnation du colonialisme, la droite et même des membres du centre prônent une adaptation. Le néerlandais Henri van Kol (qui avait des parts dans une plantation de café en Indonésie) justifiait le colonialisme.
2.5 Droitisation rampante[modifier | modifier le wikicode]
Début 1910 à nouveau, des grèves massives apparaissent spontanément, à la fois économiques (contre les patrons) et politiques (pour réclamer le suffrage universel). Rosa Luxemburg se met alors à critiquer durement la passivité de la social-démocratie, qui ne cherche pas à pousser le mouvement en avant.[9] Kautsky lui fait alors une réponse qui cautionne la politique majoritaire.[10] En privé, Kautsky s'irrite contre Luxemburg, qui ferait peur aux syndicalistes avec son gauchisme, et qui nuirait à « son influence » sur les syndicats, celle « des marxistes ».[11] Les idées de Luxemburg et de Liebknecht, celles de l'aile gauche de la social-démocratie, ont pourtant de l'écho à ce moment-là car il apparaît que les méthodes purement parlementaires et de négociation syndicale sans rapport de force ne permettent de rien obtenir : pas d'avancée sur le droit de vote, de nombreux ouvriers soumis à la répression patronale et judiciaire, impuissance face au militarisme lors notamment de la crise d'Agadir...
En 1910, le social-démocrate Gerhard Hildebrand publie un livre dans lequel il met en doute l'objectif de socialiser l'économie, appelle à former une union douanière européenne, et à s'emparer de colonies.[12] Il est exclu du SPD en 1912, parce qu'il allait vraiment trop loin.[13]
Lors des élections de 1911, la social-démocratie est unie en apparence, mais ce n'est plus réellement sous le leadership politique du SPD, mais cela devient en réalité une alliance entre la bureaucratie syndicale et la bureaucratie du SPD.
Au congrès d'Iéna de 1911, la gauche est battue par une majorité centre-droite. Sur une idée de Karl Liebknecht, on proposa à Trotski (qui était alors en exil en Europe) de parler des actes de violence commis par le gouvernement tsariste en Finlande. Mais Bebel demanda à Trotski de ne pas intervenir pour éviter d’attirer des ennuis… Trotski accepta, et Liebknecht indigné, fit lui un discours véhément contre le tsar.[14] Liebknecht, et surtout Rosa Luxemburg, représentaient l'aile gauche du parti.
Dans les cercles dirigeants du SPD, on méprise et on craint ces "Rosaleute" , qui sont une obsession constante chez Kautsky dans les années 1913-1914.
Bebel, vieillissant, décide de passer au second plan en 1911. On décide alors d'élire un co-président du parti à ses côtés, Hugo Haase, proche de Bebel. Friedrich Ebert, qui représente l'aile droite du parti, est battu de peu. Ce dernier est un homme qui a fait toute sa carrière dans l’appareil et qui considère la révolution comme un « pêché ». Et il deviendra co-président peu après, à la mort de Bebel en 1913.
En 1912, le marxiste Anton Pannekoek écrit dans la Neue Zeit qu'il faut revenir à la conception révolutionnaire de Marx. Il rappelait ses écrits de 1852 sur la dictature du prolétariat, sur la nécessité de "briser l'appareil d’État", contredisant frontalement la conception opportuniste de Kaustky selon laquelle la révolution serait seulement un "déplacement de forces" au sein de l’État.[15] L’article de Pannekoek fut accueilli comme une rechute dans un anarchisme primaire. Grand admirateur des Chemins du pouvoir de Kautsky, Lénine lui-même n’a guère pris position dans la polémique et il a plutôt continué à accepter la lecture sélective de Marx par ses héritiers officiels.
En 1913, le congrès du SPD approuve largement le vote des députés intervenus quelques temps auparavant, qui ont approuvé la création d’une nouvelle taxe pour couvrir les dépenses militaires. Le vote du 4 août 1914 est déjà acquis.
On peut noter que Bernstein assumait d'être révisionniste et réformiste, mais faisait une différence avec l'opportunisme. Pour lui, les opportunistes, contrairement à lui, n'avaient rien à faire de la théorie. Par ailleurs, il n'a pas basculé du côté des pires social-chauvins en 1914, et a critiqué le nationalisme. Il soutenait que même si la majorité des révisionnistes avaient soutenu la guerre, cela n'était pas automatique, et soulignait que beaucoup de membres de la gauche du SPD étaient aussi devenus chauvins.[16][17]
3 Le révisionnisme dans la Deuxième internationale[modifier | modifier le wikicode]
Le révisionnisme n’était pas qu’un problème allemand. Dans la mesure où ces conditions objectives et ces formes pratiques d’activité existaient, à un degré plus ou moins important, dans les autres pays, le révisionnisme de Bernstein trouva un écho sur le plan international. Il se combinait à des formes de réformisme d'autres origines et se manifestait sous des formes diverses dans toute la Seconde Internationale.
Les conflits se cristallisèrent assez logiquement sur la question de l'attitude des socialistes envers les institutions bourgeoises. La participation aux parlements était pratiquée sans soulever de questions depuis l'époque Marx, mais sa pratique était de plus en plus tournée vers l'électoralisme et la collaboration de classe.
L'autre grand problème fut la véritable trahison que représentait la participation aux gouvernements bourgeois , même si elle resta officiellement condamnée. Ce fut d'abord en France qu'en 1899 un député socialiste, Alexandre Millerand , entra au gouvernement comme ministre du commerce. Une minorité (dont Jaurès) l'a soutenu, et la majorité (dont Guesde) l'a condamné. L'Internationale s'est prononcée contre ce " ministérialisme " au congrès de Paris de 1900, mais Kautsky a fait une grave concession : il admettait que les socialistes pouvaient entrer dans un gouvernement bourgeois dans des "circonstances exceptionnelles", et par là il pensait de façon prémonitoire à... "l'hypothèse d'une guerre d'invasion"[18]. Lors du congrès international de 1904, il y eut à nouveau un débat, notamment entre Jaurès[19], Bebel[20] et Guesde[21], à l'issu duquel la condamnation officielle fut confirmée.
Le Congrès de Stuttgart en 1907 ouvre ses débats sur la question de la guerre et sur les moyens de s’y opposer. Face à la proposition des délégués français, qui prévoit la grève générale en cas de guerre, les Allemands, conduits par Bebel et Vollmar la rejettent. Bebel se refuse à envisager tout plan d’action précis. Il estime que la grève générale en Allemagne détruirait toutes les organisations. Finalement sur proposition de Rosa Luxemburg et de Lénine, entre autre, l’amendement suivant est adopté, avec les voix du centre :
« Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, ils ont le devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. »
Ce vote contribua à renforcer les illusions de la gauche tant au sein de l’Internationale que dans les sections.
L’opposition entre réformistes et révolutionnaires se manifeste dès 1903 en Russie, où le parti se divise entre mencheviks et bolcheviks, et en Bulgarie entre “ Larges ” et “ Étroits ”. En 1909, la scission se produit en Hollande. Ce sont des symptômes du fossé qui se creuse, cependant que ce soit pour Luxemburg ou Lénine, le leader des bolcheviks, il ne saurait être question de quitter l’Internationale. Pour eux, le révisionnisme est un courant qui doit être combattu. Ils ne perçoivent pas que derrière les pratiques se dresse une couche sociale particulière.
C’est seulement dans une section de la Seconde Internationale, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, que la lutte contre le révisionnisme se développa systématiquement pour parvenir à ses ultimes conclusions politiques, la refondation du combat socialiste dans ce que l'on appelé par la suite le mouvement communiste.
4 Le révisionnisme en France[modifier | modifier le wikicode]
Le révisionnisme de Bernstein a été relativement peu débattu en France, et plutôt mal accueilli[22]. Cela est dû en grande partie aux déformations de ses propos, notamment avec la mauvaise traduction française des Présupposés du socialisme. En étant d'emblée assimilé à l'opportunisme, Bernstein ne pouvait séduire largement. Même Jaurès déclarait « dans la controverse qui s’est élevée au sujet des principes et de la méthode du socialisme entre Bernstein et Kautsky, je suis, dans l’ensemble, avec Kautsky »[23], alors qu'il partageait de nombreuses conclusions pratiques avec Bernstein. Guesde a utilisé le fait que l'Internationale condamne le révisionnisme pour critiquer Jaurès et le ministérialisme (à noter cependant que Bernstein ne soutenait pas le ministérialisme).
Quelques socialistes français eurent cependant des échanges avec Bernstein, notamment des collaborateurs de La revue socialiste, comme Georges Sorel[24], Charles Rappoport[25] ou Eugène Fournière. Un révisionnisme français se développa dans un milieu de socialistes normaliens - qui s'étaient engagés au cours de l'Affaire Dreyfus et qui soutenaient Millerand. Ils éditaient Notes critiques. Science sociale, revue dominée par Lucien Herr, Charles Andler, qui avaient déjà critiqué le marxisme à la fin des années 1880. Après 1903, la génération autour de Maurice Halbwachs et surtout Albert Thomas défendra activement le gradualisme et l'intégration à la république bourgeoise. Albert Thomas rencontrera par la suite Bernstein et prenant en 1910 la tête de La revue socialiste, il dira « nous serons, à La revue socialiste, éternellement des révisionnistes », en affirmant avoir les mêmes idées que le leader du révisionnisme allemand. En réalité, Thomas déforme lui aussi la pensée de Bernstein, voulant surtout retenir la "critique de l'orthodoxie doctrinale". Thomas se retrouvera au ministère de l'armement en 1916...
5 Le révisionnisme aux États-Unis[modifier | modifier le wikicode]
Aux États-Unis, le mouvement socialiste était plus faible qu'en Europe, mais connaissait une certaine croissance dans les années 1900.
Le marxiste John Spargo mentionne brièvement le révisionnisme dans un ouvrage de 1906, à propos de ses positions économiques. Il ne semble pas alors se considérer comme en faisant partie. Il appartenait cependant à l'aile droite du parti socialiste d'Amérique, et ce qui est notable dans sa façon de décrire la révolution, c'est qu'il en fait clairement l'opinion dominante dans l'Internationale :
« Lorsque j’ai rejoint le mouvement socialiste, il y a de nombreuses années, la Révolution sociale était un événement bien réel, inévitable et proche pour la plupart d’entre nous. Les plus enthousiastes d’entre nous en rêvaient ; nous avons chanté des chansons révolutionnaires... (...)
Nous avons suffisamment grandi pour en rire rétrospectivement. Il est vrai qu'on parle encore beaucoup de révolution sociale, et il se peut qu'il y ait ici et là quelques socialistes qui utilisent le terme dans le sens que j'ai décrit ; qui croient que le capitalisme connaîtra une grande crise, qu'il y aura un soulèvement de millions de personnes en colère, une nuit de fureur et d'agonie, puis le lever du soleil de la Fraternité au-dessus de la vallée ensanglantée et de la plaine jonchée de cadavres. Mais la plupart d’entre nous, lorsque nous utilisons le vieux terme, par simple force d’habitude ou par tradition, ne pensons pas à la Révolution sociale dans un tel esprit. Nous pensons seulement au changement qui doit survenir dans la société, transférant le contrôle de quelques-uns au plus grand nombre, le changement qui se produit maintenant tout autour de nous. Quand viendra le temps où les hommes et les femmes parleront de l'état dans lequel ils vivent comme du socialisme, et considéreront la vie que nous vivons aujourd'hui avec émerveillement et pitié, ils parleront de la période de révolution comme incluant cette année même, (...). Quoi qu'il en soit, (...) aucun socialiste dont les paroles ont une quelconque influence sur le mouvement, ne croit qu'il y aura un changement soudain et violent du capitalisme au socialisme. »[26]
6 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]
Le marxisme contre le révisionnisme à l’aube du XXème siècle, conférence de David North, sur le WSWS.
Socialisme international, La trahison de la deuxième internationale
- ↑ Erich Mathias, Idéologie et pratique : le faux débat Bernstein-Kautsky, Annales, 1964
- ↑ Les luttes de classes en France, note des éditeurs
- ↑ Traduit de l’anglais : Marxism and Social Democracy: The Revisionist Debate 1896-1898, ed. H. Tudor and J.M. Tudor (Cambridge University Press, 1988), p. 74.
- ↑ Eduard Bernstein, La théorie de l’effondrement et la politique coloniale, janvier 1898
- ↑ Traduit de l’anglais : Eduard Bernstein, The Preconditions of Socialism (Cambridge University Press, 1993), p. 1.
- ↑ Traduit de l’anglais : cité dans Peter Gay, The Dilemma of Democratic Socialism (New York: Collier, 1970), p. 152
- ↑ Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou révolution ?, 1898
- ↑ Traduit de l’anglais Preconditions, p. 162.
- ↑ Rosa Luxemburg, The Next Step, Dortmunder Arbeiterzeitung, Mars 1910
- ↑ KarI Kautsky, Was nun? (Et maintenant?), Neue Zeit, 8 avril 1910
- ↑ Karl Kautsky, Lettre à David Riazanov, 16 juin 1910
- ↑ Gerhard Hildebrand, Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus. Jena, Fischer 1910
- ↑ Roger Fletcher, Revisionism and Empire George Allen and Unwin (1984) p62
- ↑ Léon Trotski, Ma vie, 16. Deuxième émigration - le socialisme allemand, 1930
- ↑ LCR-La gauche, L’Etat, la démocratie, et la révolution: retour sur Lénine et 1917, 2007
- ↑ Eduard Bernstein, Revisionism and Nationalism, 1915
- ↑ Weekly Worker, World War I: SPD left's dirty secret, 26.06.2014
- ↑ Comme il le précisa lui-même au congrès d'Amsterdam. Cf. Rakovski, Les socialistes et la guerre
- ↑ Jean Jaurès, Discours au congrès socialiste international d'Amsterdam, 1904
- ↑ August Bebel, Discours au congrès socialiste international d'Amsterdam, 1904
- ↑ Jules Guesde, Discours au congrès socialiste international d'Amsterdam, 1904
- ↑ Emmanuel Jousse, Du révisionnisme d’Eduard Bernstein au réformisme d’Albert Thomas (1896-1914)
- ↑ Jean Jaurès, Bernstein et l’évolution de la méthode socialiste, 1900
- ↑ Lettres de Georges Sorel à Eduard Bernstein (1898-1902)
- ↑ Charles Rappoport, Une vie révolutionnaire 1883-1940. Les mémoires de Charles Rappoport
- ↑ John Spargo, Socialism. A summary and interpretation of socialist principles, June 1906