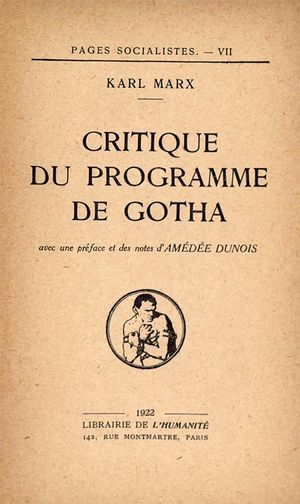Programme politique
Le programme politique d'un parti est l'ensemble des objectifs qu'il se donne.
Historiquement, et pour les partis politiques qui se donnent des objectifs de transformation profonde de la société, le « programme » a un sens large, qui inclut des principes généraux et une stratégie de long terme, en plus de revendications à défendre de façon plus immédiate.
Pour les partis les plus intégrés au fonctionnement de la démocratie bourgeoise, le « programme » est souvent réduit à un programme électoral, élaboré ponctuellement pour une élection. Il s'agit alors d'une courte liste de quelques promesses largement illusoires.
Dans le mouvement socialiste, ces deux versions se retrouvent. Dans les premiers partis social-démocrates aussi bien que dans les partis communistes, le programme était une vision d'ensemble du capitalisme et de ses contradictions, ainsi qu'une série de mesures en vue d'obtenir la démocratie et le socialisme.
1 Le programme dans le parti ouvrier[modifier | modifier le wikicode]
1.1 Programme minimum et programme maximum[modifier | modifier le wikicode]
Un des principaux clivages du mouvement ouvrier, celui entre réformisme et révolution, se traduit directement en désaccord sur la vision du programme.
Un découpage qui est venu assez spontanément lors des rédactions des premiers programmes socialistes était celui entre :
- « programme minimum » : les revendications à défendre immédiatement, telles que la démocratisation maximale (suffrage universel, droits des peuples à disposer d'eux-mêmes...) et des réformes sociales (journée de huit heures...) ;
- « programme maximum » : l'abolition du salariat par la collectivisation des moyens de production, c'est-à-dire le socialisme.
Pour tous les aspects démocratiques, les social-démocrates avaient le soutien d'autres forces, en particulier les démocrates bourgeois (bien que ceux-ci aient fini par devenir plus que modérés). Ils avaient parfois le soutien de timides franges réformatrices de la bourgeoisie pour quelques mesures sociales limitant la misère ouvrière. En revanche ils étaient seuls à défendre l'objectif socialiste, et minoritaires.
Dans la pratique politique de l'Internationale ouvrière (2e internationale), le programme maximum socialiste est peu à peu devenu comme un horizon : quelque chose vers lequel on avance mais qui s'éloigne toujours d'autant... On en parlait les jours de congrès, pour célébrer le grand idéal commun, dans quelques revues théoriques, mais dans les Parlements, les dirigeants embourgeoisés paraissaient chaque jour davantage de « raisonnables interlocuteurs » pour les partis de la classe dominante. La lutte extra-parlementaire était encore parfois utilisée comme moyen de pression, mais on n'abordait presque jamais l'idée qu'à partir d'elle on pourrait réorganiser entièrement les institutions. La trahison de facto qui s'était insinuée dans la pratique s'est exprimée au grand jour lors de l'Union sacrée de 1914, lorsque les socialistes ont renié toutes leurs promesses d'internationalisme pour se ranger chacun derrière leur propre État impérialiste.
Le mouvement communiste, qui est né de la rupture avec le socialisme réformiste, a livré une critique frontale de cette façon de séparer nettement programme minimum et maximum, et développé l'idée de revendications transitoires.
1.2 Importance du programme ou des luttes[modifier | modifier le wikicode]
Le courant marxiste a fondé sa stratégie sur l'idée que le communisme doit être l'aboutissement du « mouvement réel » de la classe ouvrière, abolissant l'ordre existant. Il se distingue donc des innombrables variantes de socialisme utopique en ce qu'il n'est pas un modèle de société sorti tout droit du cerveau d'un intellectuel (aussi généreux soit-il). Puisque « l'émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », une des tâches primordiales des communistes est de favoriser l'organisation et la lutte de masse de la classe travailleuse, plutôt que de la diviser entre « sectes ». Le terme « secte » était employé au temps de Marx et Engels dans un sens beaucoup moins péjoratif que son sens actuel : ils l'appliquaient à des petits groupes essentiellement propagandistes, comme la Ligue des communistes à laquelle ils participaient. Pour eux, ce type de groupes peuvent avoir leur importance historique, mais deviennent des entraves s'ils sont incapables de se dépasser pour fusionner dans le « mouvement réel » (au sens de masse).
C'était notamment la raison de la motivation de Marx pour s'investir dans la direction de la Première internationale (1864-1873). Au sein de celle-ci, on trouvait aussi bien des partisans de Proudhon, de Bakounine que des partisans de Marx.
Par la suite en Allemagne, alors que le mouvement ouvrier était en train de s'organiser, il existait de petits partis socialistes : principalement le « Parti d'Eisenach » (organisé par Liebknecht, proche de Marx et Engels) et la « secte lassallienne ». Cette situation a conduit au congrès d'unification de Gotha, en 1875, qui fonde le Parti social-démocrate (SPD).
Favoriser l'unité d'action pour stimuler les luttes et donc la conscience de classe était primordial pour Marx, ce pour quoi il écrit à ce moment-là : « Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes. »[1]
Cette phrase est souvent sortie de son contexte pour sous-entendre que Marx donnait peu d'importance au programme politique. Or c'est un contre-sens total. La lettre dont elle est extraite est une lettre à Wilhelm Bracke à laquelle il joignait sa Critique du programme de Gotha. Marx était justement très insatisfait du programme sorti du congrès d'unification, considérant que ses partisans avaient fait un consensus mou avec les lassalliens. Marx soutient que le congrès aurait dû se limiter à un accord pour l'unité d'action, pour ne pas entraver la « progression réelle », mais reporter à plus tard la déclaration d'un programme commun, après une expérience de la pratique. Marx estime que cette précipitation peut avoir des conséquences néfastes.
« Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes. Si donc on se trouvait dans l'impossibilité de dépasser le programme d'Eisenach, - et les circonstances ne le permettaient pas, - on devait se borner à conclure un accord pour l'action contre l'ennemi commun. Si on fabrique, au contraire, des programmes de principes (au lieu d'ajourner cela à une époque où pareils programmes eussent été préparés par une longue activité commune), on pose publiquement des jalons qui indiqueront au monde entier le niveau du mouvement du Parti. Les chefs des lassalliens venaient à nous, poussés par les circonstances. Si on leur avait déclaré dès l'abord qu'on ne s'engagerait dans aucun marchandage de principes, il leur eût bien fallu se contenter d'un programme d'action ou d'un plan d'organisation en vue de l'action commune. Au lieu de cela, on leur permet de se présenter munis de mandats qu'on reconnaît soi-même avoir force obligatoire, et ainsi on se rend à la discrétion de gens qui ont besoin de vous. Pour couronner le tout, ils tiennent un nouveau congrès avant le congrès d'unité, tandis que notre parti tient le sien post festum ! On voulait manifestement escamoter toute critique et bannir toute réflexion de notre propre parti. On sait que le seul fait de l'union donne satisfaction aux ouvriers, mais on se trompe si l'on pense que ce résultat immédiat n'est pas trop chèrement payé. »[1]
A la fin du 19e siècle, les premiers députés social-démocrates allemands se retrouvent divisés ou sans position consistante face à certaines questions politiques, comme le protectionnisme. Marx et Engels leur reprochait de n'avoir pas assez mené de discussions programmatiques et de s'être contenté de grands principes. En 1891, Engels se plaint également d'une impréparation du parti, par exemple sur la question de la réorganisation du futur État républicain. Notamment parce qu'il était interdit de revendiquer la république en Allemagne, les social-démocrates en discutaient peu.
« Que peut-il en résulter, sinon ceci que, tout à coup, au moment décisif, le Parti sera pris au dépourvu et que sur les points décisifs, il régnera la confusion et l'absence d'unité, parce que ces questions n'auront jamais été discutées ? »[2]
Dans la Deuxième internationale, il n'y avait pas de volonté de décrire précisément la transition vers le socialisme, au nom de l'idée qu'il ne fallait pas verser dans l'utopisme, renforcée par une vision très optimiste du remplacement inéluctable du capitalisme par le socialisme. Un socialiste états-unien écrivait par exemple :
« Le sujet [des moyens de réalisation du socialisme] n'est évoqué dans aucun de nos programmes (...). Nous gardons le silence sur ce sujet, non pas parce que nous craignons d'en discuter, mais parce que nous comprenons que l'affaire sera tranchée lorsque la question se posera. »[3]
Mais pour autant, de facto, différents socialistes écrivaient pour développer des éléments programmatiques, et le faisaient dans des directions de plus en plus réformistes.[3][4][5]
Lénine écrivait :
Sans programme, le parti ne peut exister en tant qu’organisme politique quelque peu cohérent capable de toujours maintenir sa ligne, quels que soient les évènements et leurs détours. Sans une ligne tactique basée sur l’appréciation du moment politique que l’on traverse, et qui donne des réponses précises aux « questions maudites » posées par l’actualité, on peut avoir un cercle de théoriciens, mais on n’aura pas une grandeur politique agissante.[6]
Trotski écrivait par ailleurs :
« Il faut lier les mains des combinards et des candidats combinards. Le programme sert à cela ou est inutile. »[7]
1.3 Divergences et scissions[modifier | modifier le wikicode]
Il est courant, et même inévitable, qu'il y ait des divergences sur certains points au sein d'organisations. Mais certaines questions sont d'importances différentes, et nécessitent d'être hiérarchisées.
Lors du congrès de 1903, les social-démocrates russes avaient tous voté le même programme, mais s'étaient divisés sur la question organisationnelle, entre bolchéviks et menchéviks. Lénine, tout en défendant son point de vue, insistait sur le fait qu'aucune scission ne serait justifiée :
« les divergences qui séparent actuellement ces deux ailes concernent surtout les problèmes d’organisation, et non les questions de programme ou de tactique (...) le programme importe plus que la tactique, et la tactique importe plus que l’organisation »[8]
Il affirmait ainsi une différence de nature entre leurs désaccords et les désaccords qui avaient existé avec les économistes :
« Auparavant, notre désaccord portait sur de graves questions qui, parfois, pouvaient même justifier une scission ; aujourd’hui, nous nous sommes mis d’accord sur tous les points graves et importants ; ce qui nous sépare maintenant, ce sont simplement des nuances sur lesquelles on peut et l’on doit discuter, mais pour lesquelles il serait absurde et puéril de nous séparer. »
Cela ne signifiait pas que le moindre désaccord sur le programme devait lui conduire à une scission, l'important étant qu'il fasse l'objet d'un accord global. Ainsi à une autre occasion il écrivait : « La critique de certains points, de certaines formules du programme est parfaitement légitime et nécessaire dans tout parti vivant. »[9]
2 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1,0 et 1,1 Karl Marx, Lettre à Wilhelm Bracke, 5 mai 1875
- ↑ Friedrich Engels, Critique du projet de programme social-démocrate de 1891, juin 1891
- ↑ 3,0 et 3,1 John Spargo, Socialism. A summary and interpretation of socialist principles, June 1906
- ↑ Karl Kautsky, Le programme socialiste, 1892
- ↑ Emile Vandervelde, Le collectivisme et l'évolution industrielle, 1904
- ↑ Lenin, The Election Campaign and the Election Platform, Sotsial-Demokrat, No. 24, October 18 (31), 1911
- ↑ Lev Trotsky, « Projet de programme de l’IC », 28 juin 1928, Œuvres t. I, ILT, p. 337
- ↑ Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, 1904
- ↑ Lénine, Our Tasks and the Soviet of Workers’ Deputies, Novembre 1905