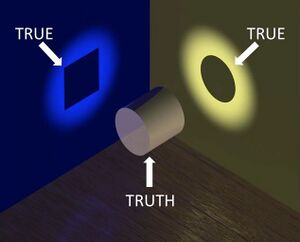Épistémologie
L'épistémologie s'intéresse à la question de comment est établie la connaissance : « comment sait-on ? », « qu'est-ce qui différencie la science de la non-science ? », etc. On parle aussi de gnoséologie ou de théorie de la connaissance.
En France, le terme d'épistémologie est souvent utilisé dans un sens plus restrictif (études des connaissances scientifiques au lieu de connaissances en général), ce qui est assez illogique vu que le terme est un emprunt de l'anglais et qu'il n'a pas cette restriction en anglais.
L'épistémologie est en général considérée comme une branche de la philosophie, même si selon certains, elle doit être considérée comme une science.[1]
1 En bref[modifier | modifier le wikicode]
Rigoureusement, quasiment toutes les opinions d'un individu moyen sont des croyances, car nous fonctionnons essentiellement par la confiance dans le reste de nos congénères, et nous passons très rarement une opinion donnée au crible d'une analyse attentive. Cela ne veut pas dire que toute croyance se vaut. [V 1]
D'un point de vue matérialiste, les opinions émises suite à des confrontations répétées avec le réel et cohérentes entre elles ont plus de probabilités d'être vraies que les autres. Selon leur socialisation, les individus et les groupes sociaux vont faire confiance à telle ou telle source d'opinion (médias, clergé, influenceurs divers, scientifiques...). La socialisation engendre aussi des biais dans la science, car tout·e chercheur·euse a des motivations plus ou moins conscientes à chercher dans une direction donnée. Mais la confrontation dialectique des idées entre elles et des idées avec les données a tendance à faire émerger de meilleures idées (contenant moins de contradictions et ayant un meilleur pouvoir explicatif). Il y a cependant de nombreuses contre-tendances : lorsque la libre discussion est entravée par de la répression, lorsque des conflits d'intérêts majeurs parasitent un champ...
2 Origines philosophiques[modifier | modifier le wikicode]
2.1 Scepticisme[modifier | modifier le wikicode]
Le philosophe de la Grèce antique Pyrrhon est connu pour son scepticisme radical, le conduisant à nier toute vérité.
S'éloignant de ces postures aussi spectaculaires que peu praticables, la philosophie a eu tendance à défendre de plus en plus un scepticisme modéré. Russel le définissait ainsi : « Ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut ».[2]
Cela se rapproche donc de ce qui est appelé « esprit critique ».
Gnoséologie
3 Épistémologie moderne[modifier | modifier le wikicode]
Comment distinguer sciences et pseudo-sciences ? Qu'est-ce qui permet de départager deux théories scientifiques en compétition ? Les sciences de la nature sont-elles « plus scientifiques » que les sciences sociales ? Ce sont ces types de questions que l'épistémologie moderne essaie de traiter.
3.1 Critères de scientificité[modifier | modifier le wikicode]
3.1.1 Réfutabilité (Popper)[modifier | modifier le wikicode]
Pertinence partielle et limites de la réfutabilité de Karl Popper
Certaines visions « à la Karl Popper » sont parfois défendues comme critère ultime, alors qu'elles sont considérées comme insuffisantes, surtout si on les applique aux sciences humaines, mais également pour les sciences de la nature.
3.1.2 Révolutions scientifiques (Kuhn)[modifier | modifier le wikicode]
La notion de changement de paradigme de Thomas Kuhn a remis en question la vision naïve d'un progrès linéaire en sciences (sans basculer dans l'ultra relativisme[3] comme le croient certains[4]), ce qui a été largement utilisé par des philosophes postmodernes.
3.2 Sciences naturelles vs sociales[modifier | modifier le wikicode]
3.2.1 Au delà de l'opposition[modifier | modifier le wikicode]
Une des grandes distinctions généralement faites dans les domaines de recherche scientifique est celle entre :
- Sciences de la nature : physique, chimie, astronomie, biologie, géologie, météorologie, climatologie...
- Sciences humaines et sociales : sociologie, histoire, psychologie, anthropologie, linguistique...
Les sciences de la nature sont souvent réputées « plus exactes ». On parle parfois de « sciences dures vs sciences molles », mais ces termes entretiennent une rivalité qui n'a pas lieu d'être. Si les sciences humaines sont moins exactes, c'est parce que leur objet d'étude est en général plus complexe à étudier. En particulier, il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de faire des expériences reproductibles en sciences humaines. Lorsqu'il se passe quelque chose dans une société ou chez un individu, il est impossible de retrouver une société ou un individu identique pour l'étudier à nouveau (sans interagir) ou pour tester une hypothèse (en agissant sur tel facteur cela aurait précisément telle conséquence...). Seuls les outils statistiques et les modèles peuvent permettre de progresser vers une compréhension un peu plus plausible.
Ce sont deux grands pôles, mais il n'y a pas de frontière très nette et étanche entre les deux. Certaines disciplines scientifiques sont au croisement des deux. Par exemple l'archéologie fait appel autant à des techniques physiques (datation au carbone 14) et biologiques (analyses ADN) qu'à des sciences sociales. Ou encore la psychiatrie est au croisement de la psychologie comme science sociale et des neurosciences comme champ de la biologie. Par ailleurs il existe aussi des limites à la possibilité de faire des expériences dans les sciences de la nature :
- en météorologie, il est quasiment impossible de faire des expériences reproductibles, et les systèmes étudiés sont des systèmes chaotiques (par ailleurs influencés par l'humanité) dans lesquels il est seulement possible de dégager des tendances ;
- en astronomie, il est impossible de faire des expériences sur les planètes et les étoiles, seulement d'inférer des lois à partir de leurs mouvements ;
- en biologie et en médecine, les systèmes étudiés sont tellement complexes et dynamiques que les expériences ne se font jamais exactement sur des sujets identiques, ce qui rend les statistiques tout aussi nécessaires qu'en sociologie...
3.2.2 Sociologie[modifier | modifier le wikicode]
La sociologie s'est délimitée progressivement de la philosophie depuis le 19e siècle. Comme les autres sciences sociales, elle a suivi ce même chemin pris par les sciences naturelles avant elles, mais la rupture est moins nette. Un certain nombre d'intellectuels se considèrent comme philosophes et sociologues, surtout parmi celleux qui assument davantage un discours idéologique.
L'usage des statistiques s'est progressivement répandu pour tenter d'objectiver des faits sociaux, mais tous les sociologues n'ont pas le même rapport à ces outils. Certains sont très sceptiques vis-à-vis des chiffres, soulignant les biais qui peuvent en fausser l'interprétation. D'autres estiment que les théories basées sur moins de données chiffrées sont encore plus susceptibles d'être biaisées.
Des sociologues comme Jean-Claude Passeron[5] et Bernard Lahire[6] ont élaboré sur la question de la méthode scientifique en sociologie :
- Le falsificationnisme de Popper n'est pas applicable pour la sociologie, car celle-ci ne propose pas de lois universelles. Contrairement à une théorie comme la gravitation, une théorie sociologique s'applique dans un cadre donné (une société organisée d'une certaine façon, donc en un lieu et une époque donnée).
- Le raisonnement sociologique est basé sur le langage courant (« raisonnement naturel »), et ne peut pas atteindre le niveau de formalisme logique de disciplines qui peuvent définir des variables clairement définies et mathématiser leurs théories. Il fonctionne largement par analogies, comme la célèbre métaphore du théâtre pour décrire les « jeux d'acteurs » des individus dans différentes situations (Erving Goffman).
- La robustesse d'une théorie peut être évaluée en la confrontant à davantage de données (par exemple lorsque Lahire nuance la théorie des champs de Bourdieu en montrant qu'elle n'explique pas bien l’œuvre de Kafka[7]).
- Pour eux le principal risque risque de faire de la mauvaise sociologie est celui de faire des généralisations abusives, ce qui peut être fait de deux façons différentes :
- se livrer à une « herméneutique libre » (c'est-à-dire une interprétation de discours faite au doigt mouillé, sans confrontation à des données) ;[V 2]
- céder à l'illusion de lois universelles (« illusion nomologique »), en fait trop abstraites pour être applicables, et masquées par une surenchère d'outils formels.
3.2.3 Histoire[V 3][modifier | modifier le wikicode]
3.3 Étude des biais[modifier | modifier le wikicode]
3.3.1 Agnotologie[modifier | modifier le wikicode]
L’agnotologie est l'étude de la production culturelle de l'ignorance[8][9] et du doute[10]. Elle peut être produite de manière volontaire ou involontaire.
Le cas d'une production d'ignorance volontaire est typiquement celui d'une stratégie délibérée par de lobbying industriel. Son illustration la plus célèbre est la stratégie délibérée de recours, par l'industrie du tabac, à des études scientifiques biaisées, destinées à jeter le doute sur les découvertes démontrant la nocivité du tabac. Mais cela a aussi été le cas pour l'amiante, le sucre, les retardateurs de flamme... Un des exemples les plus préoccupants est celui du changement climatique : aux États-Unis les lobbies des industries les plus polluantes, largement relayés par les conservateurs, parviennent à faire croire que le sujet est controversé parmi les scientifiques, ce qui fait passer le climato-scepticisme pour une position acceptable.[11]
Mais il peut y avoir d'autres formes de production volontaire d'ignorance. Par exemple, selon Linsey McGoey, certaines firmes pharmaceutiques limitent délibérément leur propre connaissance de certains effets secondaires, pour qu'en cas de problèmes ultérieurs, on ne puisse pas dire « qu'elles savaient ».[12]
Ou encore, on peut penser à toutes les informations classées comme secret d'État ou secret commercial.
Les cas de production involontaire d'ignorance sont souvent des mécanismes structurels plus indirects. Par exemple, lorsqu'un laboratoire décide d'investir dans un programme de recherche, cela tend à lui faire négliger ce qui pourrait être trouvé en explorant un autre paradigme, voire à le faire persister dans une piste peu fructueuse (on cherche les clés autour du lampadaire). C'est aussi le cas lorsque des investissements massifs ont été réalisés dans des instruments de mesure ou d'analyse coûteux : il devient plus difficile de se décider à les abandonner.
4 Marxisme et épistémologie[modifier | modifier le wikicode]
4.1 Scientificité du marxisme[modifier | modifier le wikicode]
Étant donné que Marx et Engels se sont revendiqués d'un socialisme scientifique, la question de la scientificité du marxisme se pose.
4.2 Point de vue sur la scientificité en général[modifier | modifier le wikicode]
Lénine aborde la gnoséologie (terme employé à l'époque) dans son livre Matérialisme et empiriocriticisme (1908).
Karl Korsch s'est intéressé à l'analyse épistémologique du marxisme dans Marxisme et philosophie, en 1923 .
5 Épistémologie et philosophie des sciences[modifier | modifier le wikicode]
Même si l'on considère que l'épistémologie est une branche de la philosophie, la philosophie des sciences peut être distinguée de l'épistémologie, car plus générale. Car elle peut s'intéresser par exemple aux relations entre science et société, indépendamment de la théorie de la connaissance.
6 Références[modifier | modifier le wikicode]
Vidéos
- ↑ Monsieur Phi, LA SCIENCE EST UNE CROYANCE (si c'est vrai c'est très grave) | Quelques bases en épistémologie, 8 mai 2022
- ↑ Gregoire Simpson, Raisonnement sociologique - Part. 1 - Part. 2 - Part 3, oct. 2020 - mars 2021
- ↑ Histony, Ce que le Titanic m'a appris sur l'histoire - Veni Vidi Sensi, 5 août 2020
Textes
- ↑ Vincent Citot, Pensée philosophique et pensée scientifique Indifférence réciproque, cohabitation pluridisciplinaire ou engagement interdisciplinaire ?, Implications Philosophiques – nov. 2013
- ↑ Bertrand Russell, Essais sceptiques, 1928
- ↑ Freeman Dyson rapportait que Kuhn lui a répondu vivement « Je ne suis pas kuhnien ! » à propos de ceux qui donnaient une interprétation ultra-relativiste de son épistémologie (The sun, the genome & the Internet : tools of scientific revolutions, 1999, p. 16)
- ↑ H. Sidky, The War on Science, Anti-Intellectualism, and ‘Alternative Ways of Knowing’ in 21st-Century America, Skeptical Inquirer Vol 42, No. 2
- ↑ Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique : un espace non poppérien de l'argumentation, 1991 (édition refondue et augmentée : Albin Michel, 2006)
- ↑ Bernard Lahire, L'esprit sociologique, Paris, La Découverte, 2005
- ↑ Bernard Lahire, Franz Kafka : éléments pour une théorie de la création littéraire, Paris, La Découverte, 2010
- ↑ Mathias Girel, « Agnotologie : mode d'emploi », Critique, vol. n° 799, , p. 964–977 (ISSN 0011-1600, lire en ligne).
- ↑ Mathias Girel, Science et territoires de l’ignorance, 2017 (Conférence-débat organisée par le groupe Sciences en questions à l’Inra de Bordeaux le 30 mai 2016)
- ↑ Olivier Monod, « « La Fabrique de l’ignorance », la science à l’épreuve de la triche industrielle », Libération, (consulté le 16 février 2021).
- ↑ Naomi Oreskes, Erik M. Conway, Les Marchands de doute, 2010 (également adapté en documentaire en 2014)
- ↑ Linsey McGoey, The logic of strategic ignorance, September 2012