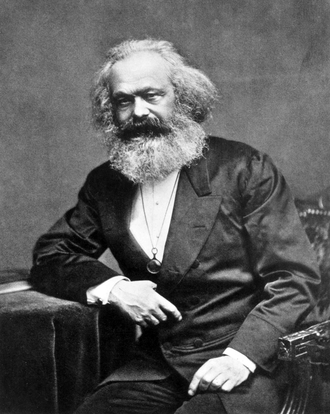Socialisme ricardien
Les « socialistes ricardiens » sont des économistes qui ont utilisé la pensée de David Ricardo, père de l'école classique en économie, pour développer une critique du capitalisme.
1 Contexte[modifier | modifier le wikicode]
Les fameux Principes de l’économie politique et de l’impôt parus en 1817 ont fait de Ricardo le nouveau maître à penser, le théoricien le plus en vue de l’école classique, le prophète du capital considéré comme créateur de civilisation et de progrès.
Mais par un effet paradoxal de boomerang, les thèses ricardiennes ont largement contribué au développement de la pensée socialiste. D’abord en posant la définition de la valeur-travail : dans la mesure où Ricardo considère le travail comme la mesure naturelle de la valeur, la valeur d’échange d’un bien étant déterminée par la quantité de travail nécessaire pour produire ce bien, l’idée sera reprise et utilisée par les socialistes, mais au profit des salariés. En second lieu, le système de distribution des revenus chez Ricardo fait du capital et du travail des concurrents directement affrontés : la part de l’un est inversement proportionnelle à la part de l’autre ; le profit varie en raison inverse du salaire. De plus c’est Ricardo qui énonce la loi du salaire minimal d’existence. Si le salaire est calculé sur la base de ce qui est nécessaire à la subsistance de l’ouvrier et à cette subsistance seulement, le surplus, produit par le travail de l’ouvrier, vient enrichir la classe possédante. Aussi est-il facile d’en déduire que les travailleurs sont les victimes du système capitaliste, puisqu’ils sont dépouillés des fruits de leur travail (même si Ricardo précise que les profiteurs sont bien davantage les propriétaires improductifs que les capitalistes). Enfin, sur le plan social, l’arme patiemment mise au point par Ricardo pour appuyer les intérêts de la nouvelle bourgeoisie est, elle aussi, retournée par les socialistes contre cette même bourgeoisie : à Ricardo qui enseignait que le véritable ennemi est le propriétaire terrien, dont les intérêts égoïstes s’opposent à ceux des autres membres de la nation, les socialistes ripostent que l’ennemi est bien moins le propriétaire tory que le capitaliste libéral. Le point de vue du Travail vient s’opposer au point de vue du Capital.
La plupart de ces économistes expriment leur pensée autour de 1825 : William Thompson publie son Enquête sur la distribution de la richesse en 1824 et son Travail récompensé en 1825 ; Gray son essai sur le Bonheur humain en 1825 ; Thomas Hodgskin sa Défense du Travail également en 1825, puis l’Economie politique populaire en 1827. On peut ajouter la brochure de Piercy Ravenstone, Doubts on the subjects of Popular and Political Economy (1821) et l’anonyme auteur de The Source and Remedies of the National Difficulties (1821). Au total, un ensemble d’analyses, élaborées de façon tout à fait indépendante les unes des autres, mais présentant de notables convergences.
Ces auteurs sont aussi, souvent, influencés par la pensée utilitariste.
2 Auteurs[modifier | modifier le wikicode]
2.1 William Thompson[modifier | modifier le wikicode]
Bien des commentateurs ont établi la réputation et l’influence de William Thompson (1783-1833) non par rapport à ses contemporains, mais par rapport à Marx. La célébrité de ce grand propriétaire irlandais, économiste et philanthrope, tient surtout à ce que l’on a vu en lui un précurseur direct du marxisme. N’est-ce point lui qui a le premier formulé l’expression appelée à devenir fameuse : la plus-value ? De fait Thompson a joué un rôle de chaînon entre l’utilitarisme, le coopératisme et le socialisme. Une des raisons qui ont restreint son audience, c’est son style. Longueurs et répétitions abondent. La redondance y est de règle. L’attention du lecteur n’est accrochée ni par des formules brillantes, ni par un souffle éloquent ou indigné. Néanmoins Thompson a contribué à forger certains concepts de base du socialisme anglais.
Son principal ouvrage intitulé An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth most conducive to Human Happiness (Enquête sur les principes de distribution de la richesse et la meilleure manière de conduire au bonheur humain) et composé de 600 pages serrées, est publié en 1824. Un nouveau pas vers le socialisme coopérateur est franchi avec le second ouvrage de Thompson, écrit en riposte à Hodgskin : Labour Rewarded. The Claims of Labour and Capital conciliated, or how to Secure to Labour the whole products of its Exertions. By one of the Idle classes (Le travail récompensé : Conciliation des droits du Travail et du Capital, ou comment assurer au travail le produit entier de son labeur. Par un membre de la classe oisive) (1827). Mais les préoccupations de Thompson ne se limitent pas à l’économie sociale, ou plutôt son souci d’émancipation et de bien-être du genre humain l’amène à se faire le champion des droits des femmes (il écrit en 1825 An Appeal of one-half of the Human Race), à prôner la limitation des naissances et à combattre la tyrannie des parents, en limitant leur « pouvoir terriblement despotique », cause de tant d’abus, au profit de la liberté des enfants. Le socialisme débouche sur la transformation de la société tout entière et pas seulement sur la transformation des relations entre le capital et le travail.
La pensée de Thompson s’alimente à deux courants : d’une part l’utilitarisme benthamien, d’autre part l’économie politique ricardienne. L inspiration utilitaire conduit Thompson à rechercher « la plus grande quantité de bonheur pour les hommes », autrement dit « le bonheur de l’ensemble ». Pour ce faire, il faut disposer des moyens de jouir des biens terrestres. La condition du bonheur, c’est une production abondante et une juste répartition des richesses (la justice s’identifiant à l’égalité dans la distribution). A ces préoccupations éthiques Thompson joint une analyse économique tirée de Ricardo, en l’interprétant dans un sens anticapitaliste. Le travail est seul créateur de la valeur, il en est la source et la mesure, et par conséquent les travailleurs doivent recevoir le produit intégral de leur labeur. C’est au contraire parce qu’ils sont victimes de l’avidité des capitalistes qu’ils sont soumis aux baisses anarchiques de production, au chômage et aux crises. Cependant Thompson concède une part au capitaliste puisqu’il est propriétaire des instruments de travail et les met à la disposition de l’ouvrier. Par conséquent le capitaliste a droit à un revenu correspondant à un dividende raisonnable sur son investissement. Il faut aussi tenir compte de la dépréciation du capital et déduire cette part du revenu ouvrier.
Malgré toutes ces restrictions plus ou moins convaincantes, et une certaine confusion entre les principes éthiques et le raisonnement économique, Thompson prend le parti du travail en face du capital. De ce point de vue de classe, il affirme que la source de tout profit est « la valeur ajoutée à la matière première par le travail dépensé sur elle et guidé par l’habileté technique. Les matières premières, les bâtiments, les machines, les salaires ne peuvent rien ajouter à leur propre valeur. La valeur additionnelle procède du travail seul ». On peut se demander dans quelle mesure Thompson n’a pas fondé sa théorie en pensant aux ateliers artisanaux et à la petite fabrique plutôt qu’à la grande usine moderne. En fait il ne s’est guère préoccupé d’observations factuelles sur l’organisation du travail. Propriétaire terrien, il n’a pas d’expérience directe, comme Owen, du travail industriel.
Ce qui toutefois le scandalise, c’est l’inégalité dans la répartition du revenu national. C’est pourquoi il lance une série d’interrogations corrosives. « Comment se fait-il qu’une nation mieux pourvue qu’aucune autre en sources de richesse, en machines, en habitations, en produits alimentaires, en producteurs intelligents et travailleurs, réunissant apparemment toutes les conditions nécessaires au bonheur... languisse malgré tout dans les privations ? Comment se fait-il que les fruits du labeur des travailleurs, après des années d’incessants efforts de production, soient mystérieusement escamotés, sans qu’eux-mêmes soient responsables de la moindre faute, sans que se soit produit de catastrophe naturelle ? Comment se fait-il que le système enrichisse une minorité aux dépens de la masse de ceux qui produisent et rende plus désespérée la misère des pauvres... ? »
Proclamant que le travail doit être libre et volontaire et que les produits du travail doivent revenir aux producteurs, il arrive à Thompson de dénoncer véhémentement les rapports de domination, d’exploitation et d’injustice entre capitalistes et travailleurs, témoin ce texte où est démonté le mécanisme de l’accumulation capitaliste et de la volonté de puissance chez les possédants. « Si l’action des capitalistes l’emporte, que se produit-il ? Stimulé par le désir de satisfaire ses désirs sans frein, d’imposer sa supériorité sans entrave aux miséreux qui l’entourent, le capitaliste éprouve le besoin d’amasser de nouveaux biens davantage encore que la joie d’en goûter. L’inégalité est sans limite : c’est une passion qui domine les hommes ; le rang que confère la richesse, l’envie qu’elle suscite poussent les hommes à l’acquérir par tous les moyens. Vertu et talents lui sont sacrifiés. On érige en loi ou en coutume tout expédient que la force et la ruse peuvent employer afin de s’approprier les fruits du labeur des autres et de réduire l’ensemble des êtres humains à l’état de forçats incultes et résignés. Il existe partout et toujours une conspiration générale des capitalistes — rassemblant évidemment les plus intelligents car leur intérêt se retrouve partout le même — pour amener les travailleurs à peiner au tarif le plus bas et pour extorquer de leur labeur de quoi renforcer au maximum la richesse accumulée et le revenu des possédants. C’est pourquoi ces individus s’acharnent à briller et à dépenser pour se faire remarquer plutôt que pour simplement jouir de leurs biens, à tel point que les produits du labeur de milliers d’hommes sont engloutis sans autre objet que la satisfaction de ces vains désirs... Les travailleurs productifs, dépouillés de tout, capital, outils, maisons, matériaux..., sont obligés, pour vivre, de trimer comme des misérables pour un salaire fixé au niveau le plus bas et calculé strictement pour qu’ils puissent juste continuer de travailler... Les méfaits de l’inégalité sont poussés à l’extrême. C’est le débordement effréné du désir de posséder. Le vrai ressort de la production, c’est le besoin. »
Parti de Bentham et de Ricardo, Thompson se convertit à Owen et au socialisme. A l’époque de l’Enquête sur la distribution de la richesse, la critique du capitalisme ne débouche pas sur des affirmations socialistes. Mais il reconnaît dans son Travail récompensé : « l’étude patiente du problème de la distribution m’a conduit au coopératisme mutuel ». Vers 1828-1829, Thompson devient l’un des animateurs de la London Co-operative Society et l’un des collaborateurs du Co-operative Magazine. Le principe de coopération est nécessaire pour aboutir à une « égalité volontaire dans la distribution des richesses ».
En même temps Thompson fait appel à l’action syndicaliste. Pour lui les syndicats, bien loin de servir comme chez Hodgskin à combattre le patronat, doivent avant tout être les pionniers du système coopératif. Ils doivent soutenir de toutes leurs forces, financières, institutionnelles et morales, la création d’expériences communautaires. Ces colonies entreront en concurrence avec les entreprises capitalistes et battront celles-ci sur le terrain de la productivité. Mais elles doivent s’assigner un but plus ambitieux encore : développer un système complet de vie communiste, dans lequel les travailleurs se retrouvent ensemble copropriétaires, coproducteurs et cohabitants. Aux travailleurs pris individuellement et aux Trade-Unions de s’engager dans le développement des « villages de coopération » owénistes : intéressante tentative pour rapprocher et allier le mouvement owenien et le mouvement syndical.
Thompson lui-même édicte en 1830 des Practical Directions for the Establishment of Communities (Directions pratiques pour l’établissement de communautés) : « La société, telle qu’elle est actuellement organisée, écrit-il, souffre avant tout de la rareté et de l’instabilité de l’emploi dans les classes laborieuses. Quelle est la première cause de ce sous-emploi ? La carence des ventes et du marché. On ne parvient pas à vendre les produits fabriqués ou ils sont bradés à un prix inférieur au coût de production ; c’est pourquoi les fabricants ne peuvent pas offrir d’emploi permanent et rémunérateur. Le remède évident est la recherche d’un marché sûr pour la plupart des produits indispensables. Le système du travail coopératif offre la solution. Au lieu de chercher vainement des marchés extérieurs dans le monde entier, qui ne sont pas plutôt trouvés que surchargés ou inondés par l’incessante concurrence de producteurs affamés, il réalise l’association volontaire des classes laborieuses. Celles-ci sont en nombre suffisant pour assurer un marché mutuel et commun, grâce au travail de tous, et pour effectuer une répartition directe et mutuelle des biens les plus indispensables en matière de nourriture, d’habillement, de mobilier et de logement. »
Thompson en appelle donc à la classe ouvrière et à ses organisations pour donner un contenu effectif aux schémas socialistes et coopératifs. C’est aux travailleurs eux-mêmes de réaliser leur émancipation, en prenant en charge des communautés de type socialiste et en commençant la construction concrète d’une nouvelle société.
2.2 John Gray[modifier | modifier le wikicode]
Malgré sa vigueur de pensée et son éloquence d’expression, Gray n’a guère trouvé d’adeptes. Son influence ne s’est pas étendue au-delà de petits cercles de réformateurs déjà convaincus. D’origine écossaise, Gray (né en 1799) vient fort jeune à Londres faire son apprentissage chez un marchand de la Cité. Observateur attentif, il assiste au déroulement des crises économiques et des agitations sociales de la période 1816-1820 et en conclut que « le système commercial est en complet désaccord avec le système de la nature ». Il suit les discussions du jour sur la surproduction et ses remèdes monétaires ou sociaux. C’est alors qu’il lit Owen et qu’il est gagné aux idées oweniennes. En 1825, Gray publie son principal ouvrage, intitulé Lecture on Human Happiness (Cours sur le bonheur humain). Joignant les actes aux paroles, il participe au financement de l’une des colonies oweniennes, à Orbiston, puis il publie un journal à Edimbourg. En 1831, Gray fait paraître son second ouvrage, le Social System, mais il a commencé à se détacher du socialisme pour se consacrer à la cause de la réforme monétaire. Il préconise alors une Banque nationale pour développer le crédit, ainsi que l’abandon de l’étalon-or (ces thèmes sont repris en 1848 dans ses Lectures on Money). La dernière partie de son existence est tout à fait rangée : à la tête d’une prospère maison d’édition écossaise, Gray fait de bonnes affaires et meurt totalement oublié en 1883 (et non vers 1850 comme on l’a longtemps supposé).
Marqué par la philosophie du XVIIIe siècle et son optimisme, par l’influence d’Adam Smith autant que de Ricardo, Gray assigne pour première tâche à la société la conquête du bonheur, « la fin et l’objet de toute entreprise humaine ». La nature, pourvu qu’elle ne soit pas pervertie par de mauvaises influences, doit spontanément y conduire, puisqu’elle a inscrit dans le cœur de chacun le désir d’association harmonieuse avec son voisin. Gray définit alors un certain nombre de principes qui doivent arracher la société à son état d’affliction et de méchanceté. Premier principe : le rôle essentiel de l’échange. Fondement du désir de vivre en société, c’est ce qui distingue l’homme de l’animal : « l’échange, et l’échange seul, est la base de la société ; toutes les autres institutions sont bâties entièrement et uniquement sur lui », tout spécialement sur l’échange du travail. Pour que règne l’équité, il faut donc donner et recevoir des quantités égales de travail. Au contraire dans la société présente, tout échange est faussé, puisque les travailleurs ne reçoivent pas un salaire à la mesure du produit réel de leur travail. Conclusion : la base de la société est viciée.
Deuxième principe : la doctrine ricardienne du travail comme fondement et mesure de la valeur est reprise, mais Gray l’applique uniquement au travail salarié et même au travail manuel portant sur la culture de la terre et sur la préparation des produits nécessaires aux besoins de l’existence. Les patrons, les marchands, les hommes des professions libérales ne sont pas productifs, même si certains d’entre eux peuvent être considérés comme utiles. Distributeurs d’une richesse créée par d’autres, ils sont en fait payés par ceux-là mêmes qui créent cette richesse sous forme de rente, d’intérêts et de profits. Seuls les travailleurs des champs, des usines et des mines sont par conséquent productifs, seuls ils contribuent à la richesse de la nation. On retrouve ici la trace des physiocrates et même l’idée d’un impôt direct et unique sur les classes productrices.
En troisième lieu, Gray s’élève contre l’inégalité et l’injustice dans la distribution des richesses. A la source de la pauvreté du plus grand nombre, il y a le fait que certains « achètent le travail à un certain prix et le revendent à un autre ». En d’autres termes « le profit est obtenu en achetant à bon marché le travail et en le vendant cher ». A la lumière de sa distinction entre producteurs et non-producteurs, Gray interprète les calculs de Colquhoun sur le revenu national en 1812. Sur une population de 17 millions d habitants du Royaume-Uni avec une production de richesse s’élevant à 430 millions de livres, 8 millions de personnes, représentant les producteurs, ont reçu 90 millions de livres, tandis que 9 millions de non-producteurs ont touché 340 millions de livres. Avec le principe de l’égalité de l’échange chaque producteur aurait dû recevoir 54 livres ; il en a en fait perçu II. Autrement dit les travailleurs ont été dépouillés des quatre cinquièmes du produit de leur travail. Et Gray de s’écrier : « Le riche qui effectivement ne paie rien reçoit tout, tandis que le pauvre qui effectivement paie tout ne reçoit rien... Un tel état social doit-il être maintenu ? N’est-il pas contraire à toute notion d’honnêteté ? »
Gray en arrive alors à la condamnation de la propriété privée et à celle des rentiers et propriétaires. Ceux-ci vivent sur le bien d’autrui. En effet ils se sont approprié ce qui ne leur appartenait pas. Ni la rente ni le loyer de l’argent n’ont de justification. Les classes possédantes tirent donc leurs revenus et vivent quotidiennement de l’injustice. En une brillante formule, annonciatrice de Marx, Gray écrit : « Le travail est le seul fondement de la propriété, et en fait toute propriété n’est rien de plus que du travail accumulé. » En même temps il s’élève contre la concurrence sans limite qui va de pair avec l’économie capitaliste. Non seulement à cause des souffrances engendrées par la concurrence, mais plus encore en raison de ses désastreux effets économiques. C’est la libre concurrence, en effet, qui est responsable de la limitation artificielle de la production. Celle-ci est restreinte par la demande au lieu de répondre aux besoins. Ce qui compte pour le producteur, c’est ce que peut absorber le marché en garantissant un profit, ce ne sont point les besoins réels des hommes (l’idée sera largement reprise et développée par le Guild Socialism près d’un siècle plus tard). La concurrence limite le revenu des travailleurs, puisqu’elle comprime les salaires, par une véritable loi d’airain ; la limitation du pouvoir d’achat limite à son tour l’expansion de la production. L’exploitation capitaliste tourne de même au détriment des capitalistes.
Le remède, Gray le voit, en bon owenien, dans la coopération ainsi que dans le développement du pouvoir d’achat qui doit stimuler la production. Ainsi sera mis fin au scandale de la misère s’étalant au milieu de l’abondance — scandale qui frappait de la même manière Owen. D’autant que grâce au machinisme la capacité de création des richesses est devenue illimitée, et par conséquent il sera possible de faire face à toutes les demandes, de fabriquer le nécessaire comme le surplus et d’accorder à chacun selon ses besoins.
2.3 Thomas Hodgskin[modifier | modifier le wikicode]
Hodgskin représente probablement la personnalité la plus attachante, après Owen, parmi les pionniers du socialisme. Sa puissance de réflexion, sa philosophie sociale, son indépendance d’inspiration par rapport à Bentham et à Owen, sa double action menée à la fois par l’écrit et par la parole, par les livres et par l’enseignement, tout concourt à faire de lui une figure forte et originale. Non content de semer un anticapitalisme à portée révolutionnaire, il exerce une influence réelle en milieu ouvrier, pousse à l’organisation syndicale, se fait l’apôtre de l’éducation du peuple. Pourtant, en dépit de sa longue existence (1787-1869), son œuvre s’inscrit en une courte période d’une dizaine d’années entre 1823 et 1833. Comme ses contemporains, critiques du capitalisme industriel, il a été lui aussi tiré de l’oubli par les socialistes de la fin du XIXe siècle, notamment les Fabiens qui ont attiré l’attention sur son caractère de précurseur de Marx, ainsi que par Elie Halévy qui lui a consacré un livre en 1903.
Les origines de Hodgskin ne le prédisposaient guère à s’occuper de la question sociale. Officier de marine, il sert sur mer au temps des guerres napoléoniennes, mais à la suite d’un désaccord dans une affaire de discipline où il se refuse à une injustice, il brise sa carrière. Mis en demi-solde, il en profite pour écrire en 1813 un Essai sur la discipline de la marine, vive critique contre l’autorité et les institutions établies. Puis il voyage à travers l’Europe, en France, en Italie et surtout en Allemagne, la plupart du temps à pied, pour mener des investigations sur l’état économique et social du continent. A partir de 1823, grâce à ses relations avec Francis Place et les utilitariens, il obtient une place de journaliste au Moming Chronicle et s’établit à Londres ; la même année il fonde avec un Ecossais le Mechanics’ Magazine, journal d’éducation ouvrière, et se met en tête de créer un Institut pour Ouvriers (Mechanics’ Institute), afin de donner aux travailleurs une formation scientifique, technique et économique. C’est donc un pionnier de la culture populaire.
Dans ses cours du soir (il enseigne l’économie politique et parmi ses auditeurs il compte certains futurs leaders du chartisme comme Lovett et Hetherington), il attaque les théoriciens du libéralisme économique, en particulier Ricardo, et expose à son auditoire ouvrier ses propres idées sur le capitalisme, système d’exploitation des travailleurs par une minorité de privilégiés, eux-mêmes soutenus par la puissance de l’Etat. Ce sont les thèmes qu’il met par écrit dans son œuvre la plus célèbre, la Défense du Travail contre les prétentions du Capital (1825) et qu’il reprend deux ans plus tard dans l’Economie politique populaire (1827). Après 1833, Hodgskin, en désaccord avec les orientations politiques du mouvement ouvrier et avec le chartisme, se retire peu à peu de la lutte et se consacre au « journalisme anonyme », selon le mot de Halévy, sans hésiter à entrer au service du très orthodoxe Economist à partir de 1843.
Pourtant la tonalité militante de son anticapitalisme lui avait valu des attaques violentes de ses anciens amis utilitariens (James Mill qualifiait les théories de Hodgskin d’« absurde folie » conduisant à la « subversion de toute société civilisée », « pire que le déluge des Huns et des Tartares »). Les adeptes de l’économie classique avaient dû riposter dans de petites brochures à bon marché et vanter les mérites du laisser-faire par la voix de la Société pour la diffusion des connaissances utiles. Bien loin de se laisser ébranler, Hodgskin dès sa Défense du Travail proclamait la toute-puissance libératrice du savoir et de la vérité. « Il n’y a pas de Sainte-Alliance qui puisse réprimer l’insurrection paisible par laquelle le savoir renversera tout ce qui n’est pas fondé sur la justice et la vérité. »
A la différence d’autres critiques du capitalisme marqués principalement par Bentham, la philosophie sociale de Hodgskin s’appuie sur Locke et la doctrine du droit naturel. Elle en reflète l’optimisme individualiste. Appliquée à la propriété et à l’Etat, cette doctrine s’élève contre les lois humaines malfaisantes et artificielles qui sont venues contrarier le cours des lois naturelles, voulues par le Créateur et génératrices du bien et du progrès. La tâche du législateur consiste donc à soutenir les lois naturelles et à empêcher qu’on ne les enfreigne. L’économique précède le politique. Du même coup Hodgskin accepte le droit de propriété, comme Locke, à condition qu’il soit établi sur des bases vraies et fermes. Ce droit est même essentiel au bien-être et à l’existence de la société. Il faut donc mettre fin au droit artificiel de propriété, imposé de force par l’aristocratie foncière et les capitalistes, et restaurer le droit naturel de propriété. Le remède au capitalisme n’est pas dans le socialisme, entendu comme un système de propriété collective, mais dans la restitution au travailleur du produit de son travail.
Hodgskin veut réfuter ce qu’il considère comme les erreurs de l’économie politique classique : l’idée du travail marchandise, l’idée de la rente produit naturel de la terre et du profit produit naturel du capital. Le travailleur, affirme-t-il, est le seul producteur de la valeur, mais le système capitaliste le contraint à accepter un salaire calculé sur le minimum nécessaire pour ses besoins vitaux. Les bénéficiaires de son labeur et de tout gain éventuel de productivité, ce sont le propriétaire foncier et le capitaliste. « Les travailleurs reçoivent seulement, et de tout temps ont seulement reçu, ce qui est nécessaire à leur subsistance ; les propriétaires fonciers reçoivent le surproduit (surplus produce) des terres les plus fertiles, et tout le reste du produit total du travail, dans ce pays comme dans les autres, va au capitaliste sous le nom de profit pour l’emploi de son capital. »
Au nom du droit des ouvriers au produit entier de leur travail, Hodgskin, tout en comptant sur une argumentation raisonnée pour convaincre et éclairer l’opinion, lance sur un ton passionné des appels à la lutte des classes. Le combat est engagé dans l’Angleterre capitaliste entre le capital et le travail. Le camp des capitalistes, qui détient à sa disposition les ressources de l’Etat, utilise la législation à son profit (par exemple les corn laws). Prenant la défense du travail, opprimé, dépouillé et incompris, Hodgskin veut renverser l’idole capitaliste : « Détournant les yeux de l’Homme lui-même, en vue de justifier l’ordre naturel de la société, fondé sur la propriété ou la possession et sur l’oppression actuelle du travailleur, qui forme malheureusement une partie de ces possessions — tous les effets glorieux [qui sont dus au travail] ont été... attribués au capital fixe et circulant ; l’habileté et l’art du travailleur sont restés inaperçus et on l’a avili pendant que l’œuvre de ses mains devenait l’objet d’un culte. »
A la place de l’idole, Hodgskin installe le travail, car c’est le travail qui est tout. Source et mesure de la valeur, c’est à lui que revient en premier le droit aux fruits du labeur. Les deux autres prétendus facteurs de production, la terre et le capital, ne créent pas de richesse. Ils ne représentent que du travail accumulé, depuis le temps des esclaves jusqu’au salariat industriel moderne. Le travail, éclairé et bien dirigé, est capable de transformer « un rocher stérile en un champ fertile ».
Après avoir établi la suprématie économique du travail sur le capital, Hodgskin pose franchement deux questions. La première est celle du droit du travailleur sur le produit de son travail. Dans une économie industrielle complexe, fondée sur la division du travail, comment connaître la part qui revient au travail de chacun ? Par conséquent, comment estimer la rémunération naturelle du travail individuel ? Il n’existe point de critère par lequel le travailleur puisse s’approprier à bon droit son produit. Sur ce point, la pensée de Hodgskin reste assez floue. En second lieu, Hodgskin reconnaît que dans le patron deux personnes et deux fonctions se trouvent confondues : l’entrepreneur, qui est un travailleur, et le capitaliste, qui est un profiteur. « Les maîtres, écrit-il, sont des travailleurs tout comme leurs ouvriers. De ce point de vue leur intérêt est le même que celui de leurs salariés. Mais ils sont aussi soit des capitalistes soit des agents des capitalistes, et à cet égard leur intérêt est nettement à l’opposé de celui de leurs ouvriers. » Pourvu que le profit injuste du capitaliste soit réduit à néant, la rémunération de l’entrepreneur est pleinement légitime.
Ce qui justifie tout, y compris la propriété, c’est le travail. L’idéal c’est que le travail soit récompensé, l’opulence et l’oisiveté sanctionnées. On retrouve là la force et la faiblesse du sentimentalisme socialiste. La doctrine déclenche un courant de ferveur, mais reste vague sur les propositions de société future. Non sans éloquence, Hodgskin s’écrie dans les pages de conclusion de sa Défense du Travail : « J’en suis certain, tant que le triomphe du travail ne sera pas parfait ; tant que le labeur productif ne sera pas le seul à être comblé et l’oisiveté la seule à être misérable ; tant que l’admirable maxime « c’est à celui qui sème qu’il appartient de moissonner » ne sera pas solidement établie ; tant que le droit de propriété ne sera pas fondé sur la justice au lieu de l’esclavage ; tant que l’homme ne sera pas à l’honneur plus que la motte de terre qu’il écrase ou la machine qu’il dirige, il ne peut ni ne doit y avoir de paix sur la Terre ni de bonne volonté parmi les hommes. »
Sur l’action à mener pour conduire à un tel progrès, Hodgskin, individualiste invétéré, éprouve une méfiance instinctive à l’égard de l’Etat. Pour lui, de tout temps, les gouvernements ont exprimé le pouvoir économique de la classe dirigeante. Tant que les privilégiés détiennent le pouvoir, la démocratie est impossible. En pleine agitation radicale pour la réforme du Parlement, Hodgskin met en garde les travailleurs contre le risque des réformes politiques : les causes du mal sont économiques. L’hostilité à l’égard de l’État s’étend à toute action politique. Puisque le vrai problème est d’ordre social et économique, à quoi bon l’action par des moyens politiques ? Ce ne peut être qu’un leurre, une dangereuse tromperie. Les penchants anarchistes de Hodgskin le situent donc à mi-chemin entre Godwin et Bakounine, tandis que ses analyses économiques le plaçaient comme un relais entre Ricardo et Marx. Refusant tout idéal coopératiste ou communautaire, Hodgskin penche pour une société de producteurs libres et indépendants. Il croit à la vertu de la lutte personnelle de chaque travailleur et accepte la concurrence — ce qui lui vaut des critiques cinglantes de William Thompson.
Ce mélange d’individualisme têtu et d’aspirations au socialisme se retrouve dans les deux modes d’action que Hodgskin veut allier pour amener le triomphe de ses idées : le syndicalisme et l’éducation. C’est aux trade-unions de s’organiser et d’unir la classe ouvrière contre l’exploitation capitaliste, et Hodgskin encourage le développement des syndicats londoniens, du moins jusqu’au jour où il les juge pervertis sans rémission par le coopératisme owenien et les confusions politiques. D’un autre côté, c’est aux Instituts de Culture pour Ouvriers qu’il appartient d’élever le niveau intellectuel des masses et d’éclairer les travailleurs sur la véritable économie politique. Hodgskin envisage donc les cours du soir comme un instrument d’émancipation et de lutte contre le capitalisme, alors que les promoteurs les plus influents de l’éducation ouvrière, comme Place et Birkbeck, y voyaient un simple moyen d’améliorer les connaissances techniques des ouvriers en même temps qu’une occasion de les rallier à l’économie classique. Finalement c’est ce point de vue — celui de la collaboration entre bourgeois éclairés et ouvriers épris de savoir — qui l’emporte, d’autant que seuls les bienfaiteurs radicaux, aux poches bien garnies et aux convictions individualistes, sont en mesure d’assurer le financement et donc le fonctionnement de ces cours. Hodgskin perd la bataille pour les Instituts ouvriers et pour la séparation du socialisme d’avec le radicalisme.
3 Socialisme ?[modifier | modifier le wikicode]
Ces auteurs ne sont pas tous des socialistes au sens strict du terme, car ils n’échafaudent pas de système collectiviste à la manière de Owen, de Fourier ou de Louis Blanc. Mais ils le sont au sens large, car leur argumentation sape les bases du capitalisme et pose les fondements théoriques d’une économie socialiste.
4 Autres auteurs[modifier | modifier le wikicode]
On peut rattacher à ce courant certains autres auteurs, qui écrivent avant ou après Ricardo, mais qui sont très proches dans l'analyse et les déduction : Charles Hall (1805), précurseur solitaire qui n’a pas fait école, et J.F. Bray (1839), théoricien plus tardif.
4.1 Charles Hall[modifier | modifier le wikicode]
Sur la personne de Charles Hall, critique acerbe de la société capitaliste, agrarien influencé par les physiocrates, mais observateur attentif de la réalité industrielle, subsiste une grande obscurité. Né aux alentours de 1740, il exerce la médecine dans l’ouest de l’Angleterre, publie en 1805 son unique ouvrage, Les effets de la civilisation sur la population des Etats européens, et meurt vers 1820 en prison pour dettes. De sa prison il a été en contact avec Thomas Spence, qui utilise certaines de ses idées. Dans une lettre à Spence il définit la mission des penseurs comme lui : c’est, écrit-il, de « convaincre à la fois les riches et les pauvres que les maux de ces derniers résultent directement et nécessairement du système social et non de la nature humaine, comme les riches et les pasteurs s’efforcent de le faire croire ».
Les effets de la civilisation attirent peu l’attention sur le moment, mais le livre est réédité en 1850 par les soins d’un disciple d’Owen, Minter Morgan, qui a fréquenté Charles Hall (d’ailleurs on note une longue recension et une critique des idées de Hall dans la publication oweniste The Economist en 1821). Son métier de médecin a mis Hall en contact avec la misère du peuple ; son livre fait allusion à plusieurs reprises à ses visites dans les foyers les plus pauvres. Ecrit l’année même de Trafalgar, en pleine ère de développement des manufactures, l’ouvrage est une dénonciation des méfaits du capitalisme industriel, responsable de la dégradation du peuple. C’est un curieux mélange de nostalgie du passé et de notations prémarxistes. Observateur critique plus que théoricien constructif, Hall occupe une position à mi-chemin entre un socialisme fondé sur une philosophie ou une éthique et un anticapitalisme basé sur l’analyse de la condition prolétarienne.
Au point de départ, il s’appuie sur une constatation : bien loin d’avoir apporté un progrès, la civilisation nouvelle a privilégié une minorité et plongé dans une misère croissante la masse de l’humanité. La vie des pauvres est brève, rude, dépourvue de tout agrément pour le corps ou l’esprit. L’agriculture étant désertée, les produits de la terre renchérissent, ce qui fait baisser le pouvoir d’achat des salariés de l’industrie et accroît leurs privations ; les travailleurs de l’industrie souffrent de mauvaise santé, d’absence d’instruction, de destitution morale et spirituelle. La cause, c’est le caractère nocif des manufactures. Hall s’accroche à l’idée physiocratique de la culture de la terre comme seule activité naturelle et productive. D’une part, l’industrie doit être restreinte au strict minimum, d’autre part la propriété privée du sol, qui est à la racine du mal, doit faire place à un système de nationalisation et de partage de la terre en petites fermes, avec redistribution périodique en s’inspirant de la loi juive et de l’exemple spartiate.
Mais si Hall s’était contenté d’exprimer cette banale et sentimentale réaction anti-industrielle et s’était confiné dans son rêve d’un retour au passé agreste, il ne mériterait guère l’attention. Il a en même temps posé trois affirmations, fort originales en son temps, qui sont comme des pierres d’attente du socialisme moderne. Tout d’abord il proclame l’existence d’un antagonisme fondamental entre les classes. Sur cette opposition absolue d’intérêt entre les riches et les pauvres, entre les producteurs et les non-producteurs, entre le Capital et le Travail, il écrit : ce que l’un acquiert ou possède, l’autre en est spolié. « Comme les termes d’algèbre plus et moins, la situation des riches et des pauvres est directement en opposition et mutuellement destructive. »
En second lieu, Hall préfigure la théorie de la plus-value. Si les propriétaires exploitent le peuple, c’est que leur richesse leur permet d’acheter le travail à un prix inférieur à sa valeur réelle. La différence, c’est le profit. En fait les riches font même un sur-profit, puisque, selon les calculs de Hall, les huit dixièmes de la population reçoivent seulement un dixième de la richesse produite. En d’autres termes, l’ouvrier travaille sept jours pour le capitaliste et « c’est seulement un jour sur huit... que le pauvre peut travailler pour lui-même et sa famille. Tous les autres jours, il travaille pour d’autres ».
Enfin Hall dénonce la paupérisation croissante des ouvriers. Alors que les riches vont s’enrichissant, les pauvres tombent dans une pauvreté toujours plus grande, à la fois en raison de leur état de sujétion face aux capitalistes disposant de la richesse et du pouvoir et à cause de l’accroissement continuel de leur nombre. Hall discerne là l’origine des guerres, dues à l’inégale distribution des richesses et au système de la propriété privée : première ébauche de l’idée que le capitalisme porte en lui la guerre...
Telles sont les anticipations de Charles Hall, ce précurseur quelque peu oublié, mêlant le socialisme agraire et l’anticapitalisme, les préoccupations morales et la méthode expérimentale, la description sociale et la statistique. Les accents de cette dénonciation virulente de la condition prolétarienne par un médecin au cœur généreux et éploré trouveront bien des émules au cours de la première moitié du XIXe siècle : le mérite de Hall est d’avoir été l’un des premiers à discerner le problème et à tenir ces propos.
4.2 John Francis Bray[modifier | modifier le wikicode]
Mi-Anglais, mi-Américain, ouvrier compositeur d’imprimerie, J.F. Bray a bâti sa réputation sur un seul ouvrage paru en 1839, Labour‘s Wrongs and Labour’s Remedy (Les maux du travail et leur remède). Ecrit d’une plume aisée avec des formulations heureuses, le livre ne manque ni de flamme ni de vigueur. Il se signale à l’attention des contemporains, d’autant plus qu’il reprend certaines des idées mises en circulation depuis une vingtaine d’années par les réformateurs sociaux. Selon le mot de Cole, il opère la « synthèse de l’owenisme et de l’économie politique antiricardienne ». Autre titre de Bray à la célébrité : sa pensée originale sur la valeur, l’échange et la plus-value, a été reconnue par Marx, qui le cite élogieusement dans Misère de la philosophie.
Né à Washington en 1809 d’un père acteur émigré et d’une mère américaine, J.F. Bray vient s’installer avec sa famille à Leeds où il travaille comme imprimeur au journal radical, le Leeds Times. Il lui arrive aussi de collaborer à la rédaction. En même temps il milite dans le trade-unionisme local. A partir de 1836, alors que Leeds devient l’une des capitales du chartisme, Bray participe à l’agitation en tant que secrétaire de l’Association des Travailleurs de Leeds. Peu après la publication de son livre, il repart définitivement pour l’Amérique, où il continue de propager ses idées, non sans les édulcorer progressivement. Il y meurt en 1895.
Préoccupée par la recherche du bonheur, la pensée de Bray part, comme celle de beaucoup de contemporains, d’une condamnation sans appel de la société existante. Cette société, Babel d’intérêts, fait d’autant plus le malheur des hommes que ceux-ci sont déterminés par leurs conditions d’existence. L’influence décisive du milieu — idée qui rappelle Godwin et Owen — s’exerce dans un système qui est le pire que l’on puisse imaginer. En effet, alors que les hommes sont faits pour vivre en communion les uns avec les autres, le monde est corrompu par l’existence de la propriété et l’antagonisme entre les oisifs et les travailleurs. Ainsi sont bafoués les principes inscrits dans le grand livre de la nature.
Quels sont ces principes conformes au droit naturel ? Au premier rang, l’égalité. Chacun a un égal droit et un égal devoir de travailler. Mais pour que règne l’égalité, il faut substituer la propriété collective à la propriété privée, en particulier la propriété du sol, puisque c’est de la terre principalement que les hommes tirent leur subsistance. Seconde idée de Bray : l’égalité du travail doit entraîner l’égalité de la rémunération. En effet, c’est du travail seul que procède la valeur. Tout être humain a droit aux fruits de son travail, alors que le régime de la propriété privée, en le privant de sa juste rémunération, entraîne tyrannie, injustice, inégalité et misère. La division en deux classes, les capitalistes et les ouvriers, vient du système inégal de l’échange. Le salarié donne au patron une journée de travail, alors qu’il reçoit la valeur d’une demi-journée : ainsi le riche s’enrichit et le pauvre s’appauvrit. En réalité, il n’y a pas vraiment d’échange. Le capitaliste ne donne rien car il n’a rien à donner, il se contente de payer le travail d’une semaine avec l’argent gagné sur le dos des travailleurs la semaine précédente. Mais il s’enrichit sans cesse, grâce à la plus-value et à l’accumulation capitaliste. La relation entre capitaliste et travailleur n’est donc que tromperie, farce, vol éhonté quoique légalisé.
Où trouver le remède ? Non pas dans l’action politique ou la législation du travail, vouées d’avance à l’échec. Ni dans le syndicalisme, qui ne peut viser qu’à l’amélioration partielle de la condition ouvrière, sans changer cette condition elle-même. Ni dans l’émigration — solution alors à la mode, mais qui ne fait que transférer le travailleur d’un lieu d’infortune à un autre. Pour aller à la racine du mal, il faut changer la base du système, c’est-à-dire introduire la propriété collective : « La communauté des biens est à tous égards la forme la plus parfaite de société que l’homme pourra introduire. » A cette économie communiste doit s’adjoindre un système collectif d’éducation des enfants, retirés à leur famille et élevés par l’Etat.
Un tel changement ne peut s’opérer en un jour, en raison des qualités de dévouement et de générosité qu’il requiert. C’est la raison (ici Bray s’exprime avec franchise et réalisme) de l’échec de certaines expériences communistes, où étaient venus dans la promiscuité s’agglutiner des êtres encore esclaves de leurs habitudes, de leurs préjugés et de leur égoïsme. Aussi à titre transitoire, en attendant un système à la manière d’Owen avec coopératives de production, de consommation et d’échange, Bray conseille le recours à des sociétés par actions (joint-stock companies), gérées par les ouvriers et formant une sorte de confédération des activités de travail. Ainsi, conformément au sous-titre du livre de Bray, à l’ère de la Puissance (Age of Might) se substituera, dans une vision optimiste de progrès indéfini de l’humanité, l’ère du Droit (Age of Right). Seul parmi les théoriciens du socialisme à être authentiquement ouvrier, Bray fait la preuve qu’il a su réfléchir sur son expérience de travailleur manuel en s’efforçant de concilier sens pratique, concepts théoriques et aspirations morales.
5 Influence sur Marx[modifier | modifier le wikicode]
Tous ces auteurs, à un titre ou à un autre, sont des précurseurs de Marx, qui a repris à son compte certains de leurs concepts et certaines de leurs analyses.
Ainsi, avant même que Marx ne prenne argument de l’analyse ricardienne dans la Critique de l’économie politique et le Capital, les pionniers du socialisme anglais tirent les conséquences logiques de l’enseignement de Ricardo. Les premiers ils le retournent, le renversent, le changent de signe. S’élevant contre la notion du travail-marchandise, ils concluent que c’est aux travailleurs seuls de s’approprier et se partager la richesse produite par leur propre labeur.
Dans quelle exacte mesure préparent-ils le marxisme et quelle est leur originalité respective par rapport à Marx lui-même ? La question a été chaudement débattue. Depuis la formule célèbre des Webb appelant Marx « l’illustre disciple de Hodgskin et de Thompson », beaucoup ont cherché à diminuer l’apport propre du fondateur du « socialisme scientifique ». Pour Schumpeter, les socialistes ricardiens sont les véritables créateurs de l’idée d’une société socialiste ; ce sont eux qui ont apporté « le levain » si nécessaire au « lourd pudding marxiste ».
A l’inverse l’historiographie marxiste a eu tendance à minimiser la contribution de Thompson, Gray, Hodgskin ou Bray, en montrant que Marx a réalisé une synthèse de la pensée hégélienne et de la critique de l’économie classique, en incorporant les diverses analyses économiques dans une théorie globale de l’histoire.